Subventions de recherche - 2025
Les subventions de fonctionnement de la SLLC, en partenariat avec d’autres organisations, financent la recherche qui peut changer de manière significative la compréhension, le diagnostic ou le traitement de la leucémie, du lymphome, du myélome, des syndromes myélodysplasiques et des néoplasmes myéloprolifératifs.
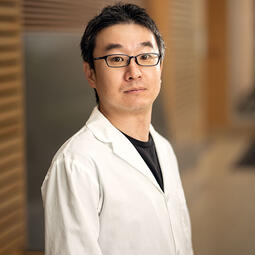
Écosystème du microenvironnement tumoral et résistance au traitement dans le contexte du LAGC
Lymphome, résistance au traitement, récidive, lymphome à lymphocytes T, cellules tumorales, cellules immunitaires
Le lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC) est l’un des sous-types les plus fréquents et les plus agressifs du lymphome à lymphocytes T. L’émergence de nouveaux traitements ciblant les marqueurs de cellules cancéreuses, tels que les inhibiteurs de l’ALK et les anticorps monoclonaux anti-CD30, ont contribué à améliorer le taux de survie des personnes atteintes d’un LAGC au cours des dernières années. Cependant, les perspectives restent limitées pour les personnes qui connaissent une récidive post-traitement, d’où l’importance de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques afin d’améliorer leur pronostic.
Dans le cadre de ce projet, nous étudierons les interactions entre les cellules tumorales et les cellules immunitaires normales qui les entourent, soit le microenvironnement tumoral. Grâce à une technologie de pointe, nous serons en mesure d’analyser des échantillons de tissus provenant de plus de 50 personnes atteintes de la maladie, afin de mieux comprendre le matériel génétique des cellules cancéreuses au niveau cellulaire et les interactions complexes qui régulent les échanges entre elles, notamment les cellules de lymphome et les cellules immunitaires. Cette recherche contribuera à approfondir notre compréhension du LAGC et pourrait ouvrir la voie à de meilleures options de traitement.
Cette subvention de la SLLC est financée en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.

Réduire le risque de rechute de la LMA grâce à une nouvelle approche immunothérapeutique
Leucémie aiguë, LMA, rechute, vaccins, anticorps, immunothérapie
La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est un cancer du sang où le risque de rechute après une période de rémission demeure fréquent, ce qui limite considérablement la survie des personnes atteintes. Les traitements de chimiothérapie actuels se sont révélés efficaces pour faire régresser la maladie, mais ils ne parviennent généralement pas à éliminer toutes les cellules cancéreuses, permettant ainsi aux cellules leucémiques résistantes de survivre et de provoquer une rechute. Pour contrer ce problème, nous travaillons activement à la mise au point de vaccins à ARN messager qui stimulent la production d’anticorps hautement spécifiques, capables de reconnaître et d’éliminer les cellules leucémiques résiduelles. Cela permettrait d’offrir une protection à long terme en maintenant la rémission de la maladie pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et d’apporter un nouvel espoir aux personnes atteintes de LMA.
Cette subvention de la SLLC est financée en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.

Mise au point de nouvelles thérapies ciblant les cellules immunitaires dans le traitement du myélome multiple
CAR-T, myélome, immunothérapie, rechute
Le recours à l’immunothérapie entraîne une évolution rapide des résultats chez les personnes atteintes de tumeurs liquides comme le myélome multiple, un cancer de la moelle osseuse touchant les plasmocytes. Les immunothérapies ciblées, notamment les anticorps bispécifiques ciblant les lymphocytes T et les cellules T à récepteurs antigéniques chimériques (CAR-T), stimulent le système immunitaire afin d’éliminer plus efficacement les cellules cancéreuses du myélome. Bien que ces traitements soient efficaces pour provoquer une rémission, ils ne mènent toutefois pas à une guérison complète et la plupart des personnes font inévitablement une rechute.
Dans nos premières études, nous avons montré que les cellules tumorales du myélome parvenaient à bloquer l’effet de l’immunothérapie par mutation des molécules cibles présentes à la surface des cellules. Dans le cadre du présent projet, nous cherchons à définir et à élaborer de nouvelles thérapies ciblées pouvant servir de traitements de rattrapage pour les personnes ayant une rechute de la maladie après avoir reçu une immunothérapie ciblée actuellement approuvée.
Cette subvention de la SLLC est financée en partenariat avec Myélome Canada.

Cibler la protéine CD59 comme nouvelle approche thérapeutique dans le traitement de la LMA
Leucémie aiguë, LMA résistante aux traitements, traitement ciblé
Notre laboratoire explore une nouvelle approche thérapeutique dans le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA), un cancer du sang particulièrement agressif. Nous avons découvert que la protéine CD59, localisée à la surface des cellules cancéreuses, favorise leur survie et leur croissance, aggravant ainsi la maladie. Nous avons créé une molécule semblable à un médicament capable de se fixer sur la protéine CD59 et de la détruire, affaiblissant les cellules cancéreuses et facilitant leur élimination. Cette molécule sera soumise à des essais en laboratoire sur des échantillons de cellules provenant de nombreuses personnes atteintes de LMA afin d’étudier son interaction avec les médicaments anticancéreux existants. Cette recherche pourrait permettre de développer un nouveau traitement pour les personnes atteintes de LMA qui ne répondent pas bien aux traitements actuels.
Cette subvention de la SLLC est financée en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.

La thérapie par cellules T pour cibler la PCSK7
CAR-T, rechute, leucémies, lymphomes, cellules immunitaires, cellules T
La manipulation en laboratoire des cellules immunitaires d’une personne atteinte d’un cancer en vue de les rendre mieux adaptées peut être extrêmement efficace dans le traitement de nombreux types de leucémies. En laboratoire, les cellules immunitaires de la personne malade (ou celles provenant d’un don) peuvent être modifiées au moyen de manipulations génétiques afin de leur conférer une meilleure capacité à éliminer les cellules cancéreuses. Le meilleur exemple est celui des cellules CAR-T, actuellement utilisées dans le traitement de certains types de lymphomes et de leucémies. Les cellules CAR-T sont un type de cellules immunitaires ayant la capacité de se multiplier et de survivre longtemps après avoir été réinjectées dans l’organisme de la personne malade.
Toutefois, en tant que « médicament vivant », la stimulation répétée des cellules T peut entraîner leur épuisement et leur inefficacité. Les cellules T épuisées peuvent finir par bloquer la réponse immunitaire anticancéreuse et ainsi conduire à une rechute.
La recherche a cependant permis de constater que la suppression de la PCSK7 dans les cellules T permettait de réactiver les cellules T épuisées et de rétablir leurs propriétés anticancéreuses. Notre objectif est donc de supprimer la PCSK7 des cellules CAR-T et d’autres cellules T antileucémiques ou antilymphomateuses afin de préserver leur efficacité.
Cette subvention de la SLLC est financée en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.

Profilage spatial et immunologique de cellules T en état d’épuisement dans les cas de rechute post-greffe de cellules souches hématopoïétiques
Greffe de cellules souches, rechute, détection, LMA, leucémie myéloïde aiguë, lymphocytes T
Les greffes de cellules souches consistent à remplacer les cellules hématopoïétiques pathologiques d’une personne atteinte de leucémie par des cellules saines provenant d’un don. Bien que ce traitement démontre une efficacité notable dans les cas de LMA, de nombreuses personnes ont toutefois une rechute, souvent fatale dans les deux années suivant la greffe. La rechute post-greffe se distingue de celle observée après une chimiothérapie conventionnelle dans la mesure où elle résulte fréquemment d’un phénomène d’« échappement du système immunitaire ». Celui-ci se produit lorsque les cellules leucémiques parviennent à contourner les défenses immunitaires du greffon, soit en se dissimulant, soit en affaiblissant les cellules T chargées de les éliminer. Ces cellules T peuvent alors entrer dans un état d’« épuisement » et perdre leur efficacité à empêcher la progression de la maladie.
Cette étude portera sur les mécanismes d’épuisement des cellules T et d’échappement immunitaire qui contribuent à la rechute post-greffe dans la LMA, afin de mettre au point un outil de suivi permettant la surveillance et le dépistage précoce des rechutes. Des méthodes de dépistage et d’imagerie de pointe permettront l’analyse d’échantillons sanguins et médullaires provenant de personnes greffées ayant eu une rechute. L’objectif est de développer un outil de suivi qui permette de déterminer, de manière précoce, le risque de rechute et d’optimiser les stratégies thérapeutiques visant à prolonger la rémission. Cette étude pourrait améliorer la prise en charge post-greffe et ouvrir la voie à de nouvelles approches prophylactiques des rechutes.
Cette subvention de la SLLC est financée en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.

Le métabolisme redox comme cible dans le traitement de la LLA à précurseurs T
LLA à précurseurs T, leucémie lymphoblastique aiguë à lymphocytes T, rechute précoce, résistance au traitement
La leucémie lymphoblastique aiguë à lymphocytes T (LLA-T) est un type de cancer agressif des cellules sanguines qui touche chaque année des enfants et des adultes au Canada. La leucémie lymphoblastique aiguë à précurseurs T, ou LLA à précurseurs T, est un sous-type distinct de LLA associé à une rechute précoce et à un mauvais pronostic. La LLA à précurseurs T ne répond pas à la chimiothérapie à un stade précoce, et peu de traitements sont approuvés à l’heure actuelle pour le traitement de la LLA à précurseurs T récidivante.
Le métabolisme des cellules cancéreuses se distingue de celui des cellules saines, notamment par sa complexité. Le métabolisme redox agit comme un système de régulation et d’équilibre énergétique interne à la cellule en utilisant des molécules telles que les espèces oxygénées activées (ROS) pour assurer son bon fonctionnement. Dans le cas de la LLA à précurseurs T, ce système est perturbé, ce qui favorise la prolifération et la mutation des cellules cancéreuses, qui deviennent alors plus résistantes au traitement. Le traitement actuel de la LLA-T comprend plusieurs molécules qui ont pour effet d’inhiber les voies métaboliques nécessaires à la survie et à la croissance des cellules leucémiques, voies qui sont présentes dans la LLA-T, mais pas dans la LLA à précurseurs T.
Ce projet permettra de mieux comprendre l’altération des voies métaboliques dans la LLA à précurseurs T et de mettre à profit des outils de pointe pour déterminer les cibles thérapeutiques susceptibles d’inhiber ces voies. Notre étude permettra également de mieux comprendre le métabolisme spécifique à la LLA à précurseurs T et d’évaluer les effets de certains nouveaux agents thérapeutiques sur sa régulation et son potentiel d’éradication des cellules cancéreuses.
Cette subvention de la SLLC est financée en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.

Une nouvelle cible – L’édition du génome comme thérapie novatrice contre les lymphomes
Lymphome à lymphocytes B, traitement ciblé, cellules immunitaires, édition du génome
Les lymphomes à lymphocytes B sont des cancers du sang qui prennent naissance dans les lymphocytes B, un type de cellule du système immunitaire. Les lymphocytes B ont la capacité de modifier rapidement leur ADN pour produire des anticorps et combattre les infections. Ces modifications de l’ADN peuvent toutefois entraîner des altérations géniques responsables de lymphomes.Les traitements actuels, comme la chimiothérapie, ciblent le résultat de ces altérations, mais ne s’attaquent pas à la cause première, soit l’ADN muté dans les cellules tumorales.
Et si nous pouvions réparer directement l’ADN défectueux à l’origine de cancers? CRISPR‑Cas9, un « ciseau moléculaire » révolutionnaire, a rendu possible la modification précise de l’ADN. Cependant, l’édition du génome (EG) reste inexplorée en tant que thérapie directe contre le cancer en raison de deux défis majeurs : 1) il demeure difficile de cibler les cellules tumorales sans altérer les cellules saines et 2) l’efficacité de la réparation des gènes dans les cellules tumorales à l’aide des outils d’EG actuels est encore très faible.
Notre projet vise à développer des outils d’EG innovants permettant de cibler efficacement les cellules tumorales dans les lymphomes à lymphocytes B. Nous espérons jeter les bases d’une nouvelle génération de traitements qui s’attaquent directement à la source génétique du cancer, et qui conduiront à des avancées thérapeutiques pour les personnes atteintes de lymphome à lymphocytes B.
Cette subvention de la SLLC est financée en partenariat avec AstraZeneca Canada.

La perturbation de l’autophagie potentialise la réponse dans les cas de myélome multiple
Myélome, pharmacorésistance, cellule immunitaire, immunothérapie
Bien que le myélome multiple (MM) demeure incurable en raison de sa pharmacorésistance, la découverte de nouvelles vulnérabilités moléculaires continue d’être une stratégie prometteuse pour améliorer la prise en charge de la maladie. Après la découverte de la kinase PIKfyve comme cible thérapeutique dans le MM, nous avons développé le PIK-001, un puissant inhibiteur de la kinase PIKfyve. L’inhibition de la kinase PIKfyve perturbe les processus cellulaires et, contre toute attente, augmente le nombre de protéines présentes sur la cellule qui transmettent au système immunitaire le signal d’activer la réponse antitumorale.
Nous chercherons à comprendre les conséquences moléculaires de la régulation immunitaire dans les cellules cancéreuses du MM par l’inhibition de la kinase PIKfyve. Nous déterminerons ensuite si l’inhibition de la kinase PIKfyve peut être utilisée en association avec des immunothérapies efficaces sur des lignées cellulaires de myélome et des échantillons prélevés chez des personnes atteintes de MM. Enfin, nous évaluerons l’efficacité de l’inhibition de la kinase PIKfyve en association avec des anticorps bispécifiques, des inhibiteurs du point de contrôle et de nouvelles thérapies prometteuses ciblant les récepteurs des lymphocytes T. Ces travaux visent globalement à établir l’inhibition de PIKfyve comme nouvelle option de traitement du MM, traitement qui non seulement induit la mort des cellules tumorales, mais améliore aussi l’immunité antitumorale, permettant ainsi de relever les principaux défis thérapeutiques liés au MM et d’améliorer les résultats pour les personnes qui en sont atteintes.

Analyse des biomarqueurs inflammatoires dans la leucémie lymphoblastique aiguë à lymphocytes T
LLA-T, pharmacorésistance, traitement ciblé, cellules leucémiques, thérapie personnalisée
La leucémie lymphoblastique aiguë à lymphocytes T (LLA-T) est un cancer du sang agressif. Les personnes qui en sont atteintes répondent généralement de manière peu favorable à la chimiothérapie conventionnelle, ce qui mène souvent à une progression de la maladie, à une aggravation des résultats cliniques et à des effets secondaires associés à des traitements inefficaces. Nos récentes recherches ont montré que certaines personnes atteintes de LLA-T présentant une réponse biologique caractérisée par une « activation des gènes inflammatoires » et une faible réponse aux traitements classiques répondent bien au vénétoclax. Notre but est de mieux reconnaître ces personnes et leur offrir un traitement plus efficace.
Nous voulons également être en mesure d’identifier les protéines sur les cellules leucémiques (appelées biomarqueurs) qui nous permettront de mieux diagnostiquer le type spécifique de LLA-T et, par conséquent, de déterminer le traitement le plus efficace pour chaque personne. En mettant l’accent sur les thérapies personnalisées, nous cherchons à améliorer les résultats pour les personnes atteintes de LLA-T, à atténuer les effets secondaires et à rendre les traitements plus efficaces.
Cette subvention de la SLLC est financée en partenariat avec AstraZeneca Canada.

Cibler l’hématopoïèse clonale liée à la mutation du gène TP53 dans les néoplasmes myéloïdes d’origine médicamenteuse
CAR-T, néoplasmes myéloïdes d’origine médicamenteuse, résistance au traitement, chimiothérapie, inflammation
La thérapie par cellules T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) est un type d’immunothérapie utilisé pour traiter un grand nombre de cancers. Elle consiste à prélever des lymphocytes (un type de globules blancs) chez la personne atteinte, à les manipuler afin de les rendre plus efficaces pour éliminer les cellules cancéreuses, puis à les réinjecter dans la circulation sanguine de la personne. La thérapie CAR-T s’est montrée très efficace, mais présente néanmoins certains risques. Un des principaux inconvénients de cette thérapie est l’augmentation du risque de cancers du sang appelés néoplasmes myéloïdes d’origine médicamenteuse, qui peuvent apparaître après une chimiothérapie ou une radiothérapie visant à traiter le cancer initial. Le pronostic des néoplasmes myéloïdes d’origine médicamenteuse est très sombre en raison de leur agressivité et de leur résistance aux traitements actuels.
Les personnes recevant la thérapie CAR-T présentent également des risques élevés d’hématopoïèse clonale, une affection précancéreuse touchant au moins 10 % des personnes de plus de 70 ans en bonne santé. Le recours à la chimiothérapie en association à la thérapie CAR-T vise à favoriser la tolérance de l’organisme de la personne traitée aux cellules CAR-T modifiées et à éliminer les cellules cancéreuses. Toutefois, ce traitement peut déclencher la prolifération de cellules précancéreuses, conduisant ultérieurement au développement d’un néoplasme myéloïde d’origine médicamenteuse. Cette phase représente, selon nous, une fenêtre thérapeutique au cours de laquelle les cellules hématopoïétiques clonales pourraient être ciblées afin d’en prévenir l’apparition.
Cette subvention de la SLLC est financée en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.
En cette époque marquée par la mise au point de médicaments ciblés et immuno‑oncologiques chez l’adulte, on constate que très peu de ces nouveaux traitements efficaces ont été adaptés pour traiter les cancers du sang chez l’enfant. Bien que des progrès aient été réalisés dans ce domaine, les taux de guérison demeurent faibles pour certains types de cancer du sang et les traitements habituels sont associés à des effets importants à long terme. Ce programme vise à remettre en question le paradigme actuel des traitements des cancers du sang pédiatriques en vue de combler les lacunes et d’améliorer les résultats.
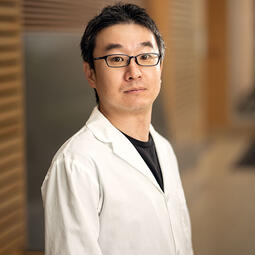
Taxonomie moléculaire et interactions immunitaires spécifiques au lymphome hodgkinien pédiatrique
Lymphome hodgkinien, rechute, enfance, adolescence, début de l’âge adulte, génome, cellules immunitaires
Le lymphome hodgkinien est l’un des cancers les plus fréquents chez la clientèle pédiatrique, adolescente et au début de l’âge adulte. Bien que le taux de survie a connu une nette amélioration au cours des dernières décennies, les résultats sont moins encourageants en cas de rechute post-traitement. De plus, les effets secondaires liés au traitement, notamment l’infertilité, l’apparition de cancers secondaires et le risque de cardiopathies, constituent un réel enjeu pour les jeunes qui survivent à un lymphome hodgkinien. Cette recherche vise ainsi à améliorer le taux de survie lié à la maladie et à prolonger la durée de vie avec le moins d’effets secondaires possible.
Nous proposons ainsi de caractériser le génome (soit l’ensemble de l’information génétique) qui compose le lymphome hodgkinien pédiatrique afin de comprendre en quoi les modifications génétiques des cellules cancéreuses affectent les cellules immunitaires environnantes. Nous étudierons les interactions génomiques et immunitaires entre les personnes atteintes d’un lymphome hodgkinien pédiatrique et celles atteintes d’un lymphome hodgkinien adulte pour établir les principales distinctions. Ces travaux nous permettront de mieux comprendre les particularités du lymphome hodgkinien auprès de la clientèle pédiatrique, adolescente et au début de l’âge adulte par rapport à celui observé chez l’adulte. Nous espérons que ces résultats nous serviront à mettre au point de nouveaux traitements et examens diagnostiques pouvant être utilisés par tous les établissements de soins, de sorte que les traitements puissent être personnalisés, avec des taux de réussite plus élevés et moins d’effets secondaires.

Cibler l’O-GlcNAc transférase dans la LMA infantile pédiatrique des taux élevés du gène EVI1
Leucémie aiguë, LMA pédiatrique, chimiothérapie, résistance au traitement, ARN, mort cellulaire
La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est un cancer du sang très agressif, et les enfants présentant des taux élevés du gène EVI1 (LMA EVI1+) ont un pronostic particulièrement défavorable. Les traitements actuels étant inefficaces, des stratégies thérapeutiques nouvelles doivent être mises au point rapidement. Nos recherches se concentrent sur la O-GlcNAc transférase (OGT), une protéine qui favorise la résistance des cellules leucémiques au traitement en inhibant la mort cellulaire. Nous avons découvert que les cellules EVI1+ AML ont des niveaux élevés d’OGT, rendant le cancer plus résistant à la chimiothérapie. Notre étude vise à inhiber l’OGT afin d’augmenter l’efficacité du traitement.
Nous étudierons la manière dont l’OGT augmente le taux de survie des personnes atteintes de leucémie en modifiant les granules de stress, les structures cellulaires qui stockent l’information génétique et évitent la mort cellulaire. En bloquant l’OGT, nous cherchons à perturber le fonctionnement des granules de stress et à augmenter la sensibilité à la chimiothérapie. Les stratégies ciblant l’OGT seront soumises à des études sur des modèles précliniques de leucémie afin d’évaluer leur potentiel pour de futurs essais cliniques. Notre étude pourrait mener à une avancée décisive pour les enfants atteints de LMA dont la probabilité d’échec thérapeutique ou de rechute est plus élevée, ouvrant ainsi la voie à des traitements plus sûrs et plus efficaces.

Échantillonnage adaptatif sanguin des génomes leucémiques pour une application clinique
Leucémie pédiatrique, diagnostic, tests génomiques
La leucémie est le cancer pédiatrique le plus fréquent, représentant un tiers de tous les cas de cancers pédiatriques. Un diagnostic rapide et précis est essentiel pour déterminer le traitement approprié, améliorer le taux de survie et réduire les effets indésirables à long terme. Cependant, les méthodes diagnostiques actuelles reposent sur plusieurs tests réalisés sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, retardant potentiellement les décisions thérapeutiques critiques. Notre équipe vise à renverser le processus du diagnostic de la leucémie grâce à une analyse génomique du sang, ce qui permettrait de réduire le délai du diagnostic de plusieurs semaines à moins de quatre jours, tout en détectant les principales mutations génétiques nécessaires à la prise de décisions thérapeutiques.
Notre approche permettra de détecter avec précision toutes les mutations génétiques actuellement répertoriées grâce à de multiples tests, tout en évaluant la rapidité avec laquelle un diagnostic peut être établi. Notre équipe, qui possède une solide expérience dans la mise au point de tests cliniques, s’engage à mettre en œuvre cette approche dans les laboratoires cliniques du Québec afin que des diagnostics plus rapides et plus précis puissent être posés chez les enfants atteints de leucémie. Cela pourrait également être élargi au diagnostic d’autres cancers pédiatriques ainsi qu’à celui de la leucémie chez l’adulte, contribuant ainsi à transformer la manière dont nous diagnostiquons et traitons le cancer.
En soutenant de nouveaux chercheurs cliniciens dans la mise en œuvre de recherches en laboratoire, en phase préclinique ou en phase clinique, les subventions pour médecins-chercheurs visent à encourager les médecins spécialistes en début de parcours à poursuivre une carrière dans la recherche sur les cancers du sang.

Améliorer l’efficacité de la thérapie CAR-T grâce au rôle prédictif des biomarqueurs de vitalité des lymphocytes T
Lymphome, rechute, CAR-T, thérapie personnalisée, biomarqueurs
Le lymphome est le sixième cancer le plus courant dans le monde et, malgré les progrès en matière de traitement, certaines personnes ne répondent pas favorablement aux traitements classiques ou font une rechute après un succès initial. Une option prometteuse pour ces personnes atteintes d’un lymphome à risque élevé ou réfractaire au traitement est la thérapie par cellules T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T). Ce traitement consiste à modifier les cellules immunitaires de la personne atteinte pour mieux cibler et détruire les cellules cancéreuses avant de réinjecter ces cellules immunitaires modifiées dans son organisme.
Cependant, la thérapie CAR-T ne fonctionne pas pour tout le monde, et de nombreuses personnes font une rechute dans l’année suivant le traitement. Notre recherche vise à comprendre pourquoi la thérapie CAR-T fonctionne chez certaines personnes et non chez d’autres, en nous penchant sur l’état des cellules immunitaires de la personne avant le traitement. Nous examinerons le métabolisme et les marqueurs protéiques de ces cellules afin de déceler les facteurs prédictifs de réussite ou d’échec du traitement. En déterminant les biomarqueurs susceptibles de révéler quelles sont les personnes les plus susceptibles de répondre favorablement à la thérapie CAR-T, nous espérerons améliorer le processus de personnalisation des traitements. Notre objectif est d’améliorer l’efficacité de la thérapie CAR-T, de prolonger la période de rémission et, ultimement, de faire de la thérapie CAR-T une option plus efficace pour les personnes atteintes d’un lymphome.

Les cellules CAR-NK dérivées de cellules souches de type iPS comme vecteurs pour la modification ciblée des gènes
Leucémie myéloïde aiguë (LMA), génétique, modification CAR-T
La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est un type de cancer du sang qui touche généralement les personnes âgées, mais elle peut également survenir chez les enfants. Malgré les meilleurs traitements disponibles, le taux de survie demeure faible. Le développement constant de nouveaux traitements ciblant l’action des gènes, dits « fusion de l’oncogène », lesquels jouent un rôle dans la progression et la persistance de la LMA, a suscité un nouvel espoir chez ces personnes. Ces gènes sont toutefois susceptibles de muter et de devenir pharmacorésistants.
Une autre stratégie qui s’est avérée efficace sur des modèles expérimentaux consiste à modifier le code génétique des gènes à l’aide de « ciseaux moléculaires » appelés CRISPR. Toutefois, l’administration de CRISPR chez les personnes atteintes de la maladie présente certaines limites. Le projet actuel vise à mettre au point un outil d’administration basé sur la thérapie CAR-T, qui consiste à modifier les cellules immunitaires de la personne atteinte afin de mieux cibler et détruire les cellules cancéreuses. Nous cherchons à adapter la thérapie CAR-T de manière à ce que la cible CRISPR soit une cellule de LMA porteuse de cette fusion oncogène. Cette approche nous permettra de cibler et d’éliminer avec précision les cellules de LMA.

Inflammation associée à l’hématopoïèse clonale à risque élevé et corrélation avec le cancer myéloïde
Mutations génétiques des cellules sanguines, néoplasmes myéloïdes d’origine médicamenteuse, cellules immunitaires
Ce projet porte sur l’hématopoïèse clonale de signification indéterminée (CHIP), une affection caractérisée par la présence de mutations génétiques dans les cellules sanguines permettant une prolifération anormale. Cette affection est plus courante chez les personnes ayant suivi un traitement contre le cancer, qui est susceptible d’augmenter le risque de prolifération de ces cellules anormales. Au fil du temps, ces cellules peuvent évoluer vers des cancers du sang agressifs, tels que les néoplasmes myéloïdes d’origine médicamenteuse, dont la croissance est très rapide. Il est essentiel de comprendre les causes de cette prolifération cellulaire et de trouver des moyens de freiner leur progression vers le cancer.
Dans le cadre d’un programme international plus large consistant à suivre des personnes atteintes d’une CHIP à risque élevé en vue d’une meilleure compréhension des mécanismes à l’origine du cancer, ce projet portera principalement sur les aspects suivants : l’analyse des cellules immunitaires, afin de déterminer si des mutations spécifiques ont des effets sur nos cellules immunitaires; l’étude des protéines responsables de la signalisation inflammatoire, afin de déterminer si certains schémas inflammatoires sont liés à une progression plus rapide de la CHIP vers un cancer du sang; l’exploration de l’activité génétique au sein des cellules immunitaires, afin de comprendre son interaction avec ses clones. Le projet vise à développer de nouveaux outils de dépistage et de suivi de la CHIP et à mettre au point des traitements précoces en prophylaxie des cancers du sang.
La recherche sur la qualité de vie pose la question suivante : « Quelles sont les conséquences d’un diagnostic de cancer et de son traitement sur la vie générale du patient? » Elle prend en compte la santé physique, mais aussi la santé mentale, les relations sociales et la capacité à faire des choses agréables et nécessaires pour vivre pleinement. Ce financement permettra d’approfondir nos connaissances sur les défis auxquels sont confrontées les personnes ayant un cancer du sang et leur famille, ainsi que sur les possibilités d’améliorer leur qualité de vie tout au long de leur expérience du cancer.

Soins palliatifs précoces chez les personnes atteintes d’un lymphome récidivant et personnes proches aidantes
Lymphome à lymphocytes B récidivant, soins palliatifs précoces, qualité de vie, patients et proches aidants
Des études ont montré que les personnes atteintes d’un cancer avec tumeur solide, de même que les personnes qui s’occupent d’elles, déclarent avoir une meilleure qualité de vie lorsqu’elles bénéficient de soins palliatifs précoces ambulatoires en plus de ceux prodigués par leur équipe soignante. Aucune étude sur les soins palliatifs précoces ambulatoires n’a été menée auprès des personnes atteintes d’un cancer du sang à ce jour, alors que celles-ci présentent des symptômes similaires à ceux des personnes atteintes d’une tumeur solide. Cette étude, la première de ce type, visera à déterminer si les personnes atteintes d’un lymphome à cellules B récidivant et leurs aidants sont disposés à se rendre dans une clinique de soins palliatifs précoces et si ces consultations contribuent à améliorer leur qualité de vie.
Cette étude portera sur 40 personnes atteintes d’un lymphome à lymphocytes B récidivant et leurs proches aidants. La moitié d’entre elles seront invitées à se rendre chaque mois à la clinique de soins palliatifs ambulatoires, en plus de leurs consultations habituelles avec leur équipe soignante traitant le lymphome. Les autres continueront de consulter uniquement leur équipe soignante traitant le lymphome. L’équipe de soins palliatifs évaluera et prendra en charge les symptômes physiques des personnes atteintes de la maladie, leur offrira un soutien émotionnel, spirituel et pratique supplémentaire, et entamera la planification des soins futurs nécessaires. Nous mesurerons le nombre de personnes qui se sont rendues à la clinique de soins palliatifs précoces et nous comparerons les résultats de l’évaluation de la qualité de vie des personnes qui se sont rendues à la clinique et de celles qui ne s’y sont pas rendues. Nous demanderons également aux personnes participantes si l’étude a changé leur perception vis-à-vis des soins palliatifs.

Renforcer la résilience des parents d’adolescents-es ayant la LLA par le numérique
Parents d’adolescents atteints de LLA, psychosocial, résilience, santé numérique
Les parents de la clientèle adolescente atteinte de leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) font face à des défis psychosociaux uniques pendant le traitement de leur enfant, notamment des inquiétudes liées à un taux de survie global plus faible et à des enjeux développementaux spécifiques à leur âge. Cette situation contribue à un niveau élevé de détresse et réduit la qualité de vie des parents. La résilience est le processus d’adaptation positive face à l’adversité. Chez les parents d’enfants atteints de cancer, la résilience est associée à une meilleure santé psychologique et physique, à une utilisation réduite des services de santé et à une meilleure qualité de vie. Pourtant, les interventions de soins centrées sur la résilience ne sont pas encore intégrées de manière courante pour ces parents.
Les interventions de santé numérique constituent un moyen accessible de fournir ce type de soutien, mais aucune intervention de ce type n’a été mise en place pour ces parents jusqu’à maintenant. Nous prévoyons la mise en œuvre d’une approche progressive centrée sur la personne afin de concevoir conjointement des interventions de santé numérique qui favorisent la résilience pour les parents d’adolescentes et adolescents atteints de LLA. Nous déterminerons les compétences essentielles à développer pour renforcer la résilience et élaborerons un prototype logiciel afin de garantir sa convivialité.
Cette subvention de la SLLC est financée en partenariat avec la Société canadienne du cancer.
Suivi à distance des symptômes chez les personnes ayant subi une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques
Greffe de cellules souches hématopoïétiques (GSCH), santé numérique, suivi des symptômes à distance, qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer et des personnes proches aidantes
La greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques consiste à remplacer les cellules sanguines affectées de la personne atteinte de la maladie par des cellules saines provenant d’un don, permettant ainsi de guérir de nombreux cancers du sang. La greffe allogénique est de plus en plus courante au Canada, où des milliers d’interventions sont réalisées chaque année. Cependant, elle est exigeante sur le plan physique et psychologique, et comporte des complications potentiellement mortelles ainsi que des effets indésirables invalidants pouvant affecter la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie pendant plusieurs années. Les personnes proches aidantes jouent un rôle essentiel dans le rétablissement des personnes malades, car elles sont appelées à prodiguer des soins complexes à domicile. Ce rôle peut peser lourd et nuire à leur qualité de vie ainsi qu’à celle des personnes malades. Quant aux prestataires de soins de santé, le manque de temps les empêche de suivre et de soulager tous les symptômes.
Le suivi à distance des symptômes, un type de service de santé numérique, offre une solution prometteuse pour répondre à ces enjeux. Il permet aux personnes atteintes de la maladie de suivre par voie électronique l’évolution de leurs symptômes en remplissant des questionnaires (p. ex., en évaluant elles-mêmes leur douleur sur une échelle de 0 à 10), dont les résultats sont rapidement envoyés aux prestataires de soins de santé pour un suivi rapide. Des ressources éducatives sont souvent incluses pour aider les personnes malades et leur famille dans la prise en charge de leurs symptômes à domicile. Le suivi à distance des symptômes s’est avéré efficace pour améliorer la prise en charge des symptômes et la qualité de vie des personnes malades dans d’autres contextes, mais son application après une greffe de cellules souches hématopoïétiques demeure inexplorée. Notre programme de suivi à distance des symptômes, qui sera conçu en collaboration avec les personnes malades, leur famille et les prestataires de soins de santé, sera mis à l’essai dans deux centres de cancérologie afin d’améliorer les résultats en matière de santé et la qualité de vie des personnes malades et de leur famille dans un contexte post-greffe.
Cette subvention de la SLLC est financée en partenariat avec la Société canadienne du cancer.

Faire face à la peur d’une récidive de cancer chez les personnes ayant survécu à un cancer pendant l’enfance
Personnes ayant survécu à un cancer du sang pédiatrique, peur d’une récidive, psychosocial, adolescents, jeunes adultes
Au Canada, environ 85 % des personnes ayant reçu un diagnostic de cancer du sang pédiatrique (p. ex., leucémie, lymphome) connaîtront la guérison à long terme, ce qui représente plus de la moitié de toutes les personnes ayant survécu à un cancer pédiatrique au Canada. Malheureusement, un grand nombre de ces personnes sont confrontées à des situations difficiles tout au long de leur vie, notamment la peur d’une récidive et une crainte persistante et envahissante que le cancer réapparaisse. Environ un tiers des personnes ayant survécu à un cancer pédiatrique souffrent de la peur d’une récidive si intense que celle-ci perturbe leur quotidien en détériorant considérablement leur qualité de vie et en provoquant de l’anxiété, des symptômes dépressifs et des difficultés à se projeter dans l’avenir. Les personnes âgées entre 13 et 25 ans sont particulièrement vulnérables à la peur d’une récidive intense, car elles sont amenées à prendre en charge elles-mêmes leur santé et à se concentrer sur leur avenir.
Ce projet vise à traiter la peur d’une récidive et à améliorer la qualité de vie des personnes à l’adolescence et au début de l’âge adulte ayant survécu à un cancer pédiatrique, la majorité d’entre elles ayant survécu à un cancer du sang. Nous adapterons un programme fondé sur des données probantes, lequel repose sur des séances de groupe animées par des thérapeutes pour les adultes ayant survécu à un cancer, afin de le rendre plus adapté à la situation des personnes à l’adolescence et au début de l’âge adulte. Nous travaillerons en étroite collaboration avec des partenaires qui sont également des personnes ayant survécu au cancer afin d’adapter le traitement et de le mettre à l’essai auprès de la clientèle adolescente et jeune adulte afin d’en évaluer la commodité et l’efficacité. Cette étude pourrait améliorer de façon significative la qualité de vie et la santé mentale des jeunes ayant survécu à un cancer du sang dans l’ensemble du Canada.

Qualité de vie des personnes atteintes d’un lymphome dans le nord-ouest de l’Ontario
Lymphome non hodgkinien, petites communautés, communautés moins bien desservies
Le lymphome est le sixième cancer le plus courant au Canada, et le nombre de personnes qui y survivent est en augmentation rapide. Pour aider ces personnes et leur famille, nous devons comprendre les facteurs qui influent sur leur qualité de vie. La plupart des données canadiennes dont nous disposons proviennent de centres spécialisés situés dans les grandes villes, ce qui ne reflète pas la réalité des petites collectivités. Nous avons besoin de davantage de données provenant de régions comme le nord-ouest de l’Ontario, où les personnes atteintes d’un cancer sont réparties sur un vaste territoire, mais ne disposent que d’un seul grand centre hospitalier offrant des soins actifs.
Dans le cadre de ce projet, nous cherchons à mieux comprendre le niveau de qualité de vie et les besoins en matière de soins des personnes atteintes d’un lymphome dans le nord-ouest de l’Ontario. Nous mènerons des enquêtes et des discussions de groupe afin de recueillir les témoignages de personnes atteintes d’un lymphome non hodgkinien dans la région. Nous tiendrons ensuite une réunion de concertation avec les personnes concernées, leurs proches aidants et les prestataires de soins de santé afin de définir les priorités en matière d’amélioration de la qualité des soins, dans le but de mieux cerner les besoins spécifiques de ces personnes en fonction de leur contexte géographique et social.
Les résultats de ce projet nous aideront à définir les facteurs qui influent sur la qualité de vie de ces personnes et de leurs proches aidants, et à trouver des moyens d’améliorer la qualité des soins prodigués. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les personnes atteintes de la maladie, leurs proches aidants et les prestataires de soins de santé afin de nous assurer que nos conclusions sont utiles et susceptibles d’influencer les pratiques et les politiques, de sorte que les autorités régionales, provinciales et nationales responsables des soins de santé tiennent compte de leur contexte géographique et social particulier.
Subventions de recherche – 2024
transferred to skip link location: 2024-subventions-catalyseur-de-l-IA-contre-les-cancers-du-sang
Alors que la quantité de données disponibles pour faire de nouvelles découvertes augmente considérablement, les chercheurs ont une occasion sans précédent de recourir aux algorithmes pour générer de nouvelles informations et mieux comprendre la maladie grâce à l’intelligence artificielle (IA) et à l’apprentissage automatique (AA). Les subventions Catalyseur de l’IA contre les cancers du sang ont pour objectif de déterminer les capacités de l’IA et les approches basées sur l’AA pour faire progresser la recherche sur les cancers du sang et les diagnostics, et pour améliorer les options de traitement pour les personnes touchées par un cancer du sang.

Les cellules primaires permettent d’identifier les cohortes de personnes atteintes de LLC présentant certaines réponses aux médicaments
La leucémie lymphoïde chronique (LLC), la plus fréquente forme de leucémie chez l’adulte, reste pour l’essentiel incurable, malgré les importants progrès réalisés dans les traitements, qui comprennent des nouveaux médicaments tels le vénétoclax et l’ibrutinib. La LLC peut varier d’un patient à l’autre, de sorte qu’une approche thérapeutique unique risque fort d’être sous-optimale.
La médecine de précision est une approche nécessaire pour adapter le traitement à chaque patient et améliorer les résultats. Une solution consiste à identifier des groupes de patients qui répondent de la même manière au traitement afin de pouvoir démontrer l’efficacité d’une nouvelle approche thérapeutique.
Les approches génétiques, notamment le séquençage génomique, ont été proposées comme moyen d’identifier ces groupes de patients. Cependant, nous avons démontré que cette méthode n’est pas prédictive de la réponse aux médicaments. Il est donc essentiel de mieux identifier les groupes de patients et de les évaluer en fonction des réponses potentielles aux médicaments, mais la meilleure méthode reste à élucider.
Notre hypothèse est que les indicateurs nécessaires pour prédire les réponses aux médicaments sont présents dans les cellules cancéreuses des patients et peuvent être visualisés à l’aide d’un microscope; les données recueillies peuvent ensuite être enrichies par l’intégration des analyses d’expression génique et interprétées à l’aide de l’intelligence artificielle. Notre objectif est d’identifier des groupes de patients présentant des réponses prévisibles similaires aux médicaments et d’utiliser ces informations pour concevoir les prochains essais cliniques qui permettront d’améliorer les traitements.

Classificateurs d’apprentissage automatique pour la détection non invasive de lymphomes dans le plasma
Cette étude porte sur une nouvelle façon de détecter les lymphomes, en utilisant des « biopsies liquides » (échantillons de sang). Actuellement, une maladie est souvent diagnostiquée et suivie à l’aide d’analyses sanguines – en particulier, des numérations globulaires qui dénombrent les cellules sanguines de différents types dans les échantillons de sang. Cependant, une simple numération globulaire ne fournit généralement pas d’information permettant de confirmer la présence ou l’absence de lymphome chez un patient.
Il serait très utile de mettre au point une méthode non invasive pour détecter le lymphome et suivre son évolution avec des biopsies liquides, en particulier après le traitement, pour aider à déterminer si celui-ci a entraîné une réponse complète, au-delà de ce que révèlent les techniques d’imagerie habituelles.
Nous prévoyons d’utiliser une technique innovante qui nous permet de mesurer de petites quantités d’étiquettes chimiques dans les cellules sanguines. Chez un patient atteint d’un cancer tel qu’un lymphome, ces étiquettes présentent des anomalies. Bien que ces étiquettes se trouvent généralement dans l’ADN des cellules tumorales, de petites quantités de cet ADN sont libérées dans la circulation sanguine et peuvent être détectées dans des échantillons de sang.
Nous prévoyons d’utiliser des programmes informatiques (apprentissage automatique) pour faire la distinction entre les cas de lymphome et les personnes en bonne santé, ainsi qu’entre les différents types de lymphome. L’objectif est d’établir des modèles fiables de modifications de l’ADN qui permettraient de détecter avec précision les lymphomes. Ces modèles pourraient contribuer au diagnostic du lymphome et à l’évaluation de l’efficacité des traitements.

Détection spectrale automatisée et assistée par l’IA de cellules individuelles de myélome multiple
Le myélome multiple (MM) est un cancer du sang actuellement incurable. Notre objectif est d’améliorer la détection et le suivi des cellules du MM chez les patients au stade précoce de la maladie, appelé « myélome multiple indolent », ainsi que chez les patients en rémission, présentant une maladie résiduelle minime (MRD) après une ou plusieurs lignes de traitement.
Nous identifierons les cellules de MM à l’aide d’une nouvelle méthode d’imagerie appelée « imagerie spectrale ». L’imagerie spectrale, qui utilise un balayage automatisé et guidé par l’intelligence artificielle (IA), identifie avec une grande précision les cellules tumorales du sein; ce type d’imagerie sera maintenant utilisé pour la première fois pour le MM.
Nous utiliserons des biopsies liquides (échantillons de sang) au lieu des ponctions de moelle osseuse, qui sont douloureuses et posent un risque d’effets secondaires. Nous pensons que ce projet nous fournira de nouveaux outils pour détecter, d’une manière peu invasive, rapide et fiable, des cellules individuelles de MM chez les patients souffrant de SMM et de MRD. Cela permettra de prendre des décisions thérapeutiques appropriées et d’assurer un suivi efficace des personnes ayant le MM afin de contribuer à la mise au point d’un traitement curatif.

Lauréat 2024 du prix de reconnaissance spécial des TUAC
Application de l’IA à l’analyse d’images numériques de cellules sanguines pour détecter l’hématopoïèse clonale
Avec le vieillissement de l’organisme, les cellules souches de la moelle osseuse développent des mutations aléatoires dans leur ADN. Certaines de ces mutations n’ont aucun effet, mais d’autres peuvent entraîner une division cellulaire trop rapide, conduisant parfois à des cancers tels que la leucémie. Dans d’autres cas, les cellules ne se multiplient pas aussi rapidement; c’est ce qu’on appelle l’hématopoïèse clonale de signification indéterminée (CHIP, clonal hematopoiesis of indeterminate potential).
On retrouve une CHIP chez environ 10 % de la population âgée de plus de 70 ans; ces patients sont non seulement exposés à un risque accru de cancer du sang, mais aussi de maladie cardiaque, de maladie pulmonaire et de nombreuses autres maladies inflammatoires. Les cas de CHIP ne peuvent actuellement être diagnostiqués qu’au moyen de tests génétiques; mais comme ces tests sont rarement effectués pour la population générale, la plupart des cas ne sont pas diagnostiqués.
Cependant, les prises de sang sont fréquentes dans la population, et des milliers de lames de sang sont examinées au microscope chaque jour. Cela permet de détecter de nombreux cancers du sang et d’autres affections sanguines, parfois bien avant l’apparition de symptômes.
Toutefois, comme aucun changement dans l’aspect des cellules sanguines n’est décrit pour la CHIP jusqu’à présent, cette grande quantité de données est perdue. Nous voulons employer l’intelligence artificielle capable d’analyser des images afin de tester la capacité à diagnostiquer la CHIP à partir de lames de sang. Cela pourrait nous permettre de diagnostiquer plus facilement la CHIP pour la traiter à l’avenir, et de dépister les maladies associées.
En soutenant de nouveaux chercheurs cliniciens dans la mise en œuvre de recherches en laboratoire, en phase préclinique ou en phase clinique, les subventions pour médecins-chercheurs visent à encourager les médecins spécialistes en début de parcours à poursuivre une carrière dans la recherche sur les cancers du sang.

Mutations communes de la chaîne ß du récepteur de la cytokine dans les lymphomes médiastinaux
Les lymphomes qui se développent dans la cavité thoracique sont collectivement appelés « lymphomes médiastinaux ». On sait actuellement peu de choses à leur sujet, et sur les raisons pour lesquelles les thérapies n’éliminent pas le cancer chez certains patients.
Les lymphomes médiastinaux touchent typiquement les jeunes. Il est essentiel de découvrir des thérapies plus efficaces et moins toxiques. Notre équipe a déjà réalisé de nombreuses études génétiques qui ont permis de mieux comprendre les caractéristiques biologiques des lymphomes médiastinaux.
Cette proposition, qui s’appuie sur notre solide base de recherche, explorera l’influence des mutations du gène CSF2RB, qui ont été identifiées dans les lymphomes médiastinaux, mais pas dans les autres principaux lymphomes. Les objectifs de notre étude comprennent l’amélioration des taux de guérison, la réduction des effets secondaires liés au traitement et l’amélioration des soins aux patients atteints de lymphomes médiastinaux.
Évaluer l’effet de la marginalisation chez les receveurs de greffe de cellules souches
La greffe de cellules souches (GCS) est une procédure révolutionnaire pour traiter les cancers du sang. La personne traitée reçoit une chimiothérapie à fortes doses, puis on lui administre ses propres cellules souches préalablement prélevées (GCS autologue) ou des cellules souches provenant d’un donneur (GCS allogénique). Cette intervention complexe aux nombreux effets secondaires n’est pratiquée que dans certains centres, mais peut potentiellement sauver la vie des patients.
Il est essentiel de comprendre comment les déterminants sociaux de la santé influent sur les soins prodigués aux patients. Des études antérieures ont montré que le niveau d’éducation, le revenu et la race peuvent avoir une incidence sur les résultats en matière de santé. Le terme « marginalisation » fait référence aux effets des facteurs sociaux et liés à la santé sur une personne.
L’Indice de marginalisation ontarien a été créé à partir des données du recensement pour étudier la marginalisation dans la province la plus peuplée du Canada. Cet indice évalue les aspects de la marginalisation, notamment la précarité du logement, l’accès aux ressources de bases, le fait de ne pas être de race blanche, et le manque d’emploi.
Dans cette étude, nous tentons de comprendre l’effet de la marginalisation sur la survie après une GCS. Nous évaluerons le taux de survie deux ans après la GCS et déterminerons si les patients les plus marginalisés ont un meilleur ou un moins bon taux de survie.

RARS2 mitochondrial : biologie et létalité synthétique dans la LMA
La leucémie myéloïde aiguë (LMA), type de leucémie aiguë le plus fréquent chez l’adulte, est très difficile à traiter. Il s’agit d’un cancer des cellules de la moelle osseuse qui fabriquent le sang. Au cours de la dernière décennie, de nouveaux traitements ciblés sont apparus, tels que les inhibiteurs des gènes mutés IDH, FLT3 et NPM1. Le succès de ces thérapies montre comment l’identification de cibles dans les cellules de la LMA peut conduire à la mise au point de nouvelles thérapies.
Nous avons démontré qu’un sous-ensemble de cellules de la LMA dépendait davantage du métabolisme et des voies mitochondriales – ce que d’autres chercheurs ont confirmé par la suite. Dans ce projet, nous avons analysé la base de données publique Cancer Dependency Map (DepMap) afin d’identifier les éléments de la cellule qui ne sont essentiels que pour un sous-ensemble de patients atteints de la LMA. Nous avons identifié une protéine cible, appelée « RARS2 », dont la dépendance était très variable dans les lignées cellulaires de la LMA. Cette subvention permettra d’acquérir de nouvelles connaissances et, possiblement, de mettre en évidence une nouvelle cible thérapeutique ainsi que la sous-population d’échantillons de LMA la plus ou la moins susceptible de répondre à la déplétion de RARS2.
En cette époque marquée par la mise au point de médicaments ciblés et immuno‑oncologiques chez l’adulte, on constate que très peu de ces nouveaux traitements efficaces ont été adaptés pour traiter les cancers du sang chez l’enfant. Bien que des progrès aient été réalisés dans ce domaine, les taux de guérison demeurent faibles pour certains types de cancer du sang et les traitements habituels sont associés à des effets importants à long terme. Ce programme vise à remettre en question le paradigme actuel des traitements des cancers du sang pédiatriques en vue de combler les lacunes et d’améliorer les résultats.

Le rôle de XPO2 dans le développement de la leucémie chez les enfants et les adolescents atteints de LMA
La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est une leucémie difficile à traiter qui se développe chez les enfants, les adolescents et les adultes et qui est associée à des taux de rechute élevés. De nombreux médicaments de chimiothérapie utilisés pour traiter la LMA ciblent à la fois les cellules leucémiques et les cellules saines, ce qui entraîne de nombreux effets secondaires. De nouveaux agents sont donc nécessaires pour mieux cibler les cellules leucémiques sans attaquer les cellules normales non cancéreuses.
Le noyau d’une cellule contient les instructions qui permettent à la cellule de fonctionner, de croître et de se diviser. Le cancer se développe parce que les cellules prolifèrent anormalement et ne répondent pas aux signaux d’arrêt de leur noyau. Si les protéines entrent dans le noyau ou en sortent au mauvais moment, elles peuvent donner des instructions erronées à la cellule, ce qui peut contribuer au développement du cancer. Ces protéines entrent et sortent du noyau à l’aide de transporteurs, appelés « importines » et « exportines ». Bon nombre de ces importines et exportines n’ont pas été étudiées dans le domaine de la leucémie.
Nous avons récemment découvert que des niveaux élevés de l’exportine XPO2 sont associés à des résultats plus défavorables chez les enfants et les adolescents atteints de LMA. Cette étude vise à déterminer le rôle de XPO2 dans le développement de la leucémie chez les enfants et les adolescents atteints de LMA. Nous déterminerons si certains sous-types génétiques de LMA de l’enfant et de l’adolescent sont plus dépendants de XPO2 et, par conséquent, si ces sujets sont plus susceptibles de tirer profit de thérapies inhibant le fonctionnement de cette exportine.
Financé en partenariat avec Kindred Foundation, à la mémoire de Bo

Exploiter la stabilité phénotypique des blastes de la LLA pour améliorer les résultats
L’objectif de cette étude est de comprendre et de mieux prédire les causes de la récidive de la leucémie, le type de cancer le plus fréquent chez les enfants, après le traitement. Malgré les bons résultats de la chimiothérapie, trop d’enfants rechutent.
La leucémie récidivante est très difficile à traiter et de nouvelles options thérapeutiques sont indispensables. Dans cette étude, nous nous appuierons sur notre nouvelle analyse des cellules leucémiques pour mettre au point une approche pouvant nous offrir un aperçu précoce des cellules leucémiques les plus susceptibles de provoquer une rechute. En identifiant et en caractérisant ces cellules, nous pourrons peut-être concevoir de meilleures avenues pour les éradiquer avant qu’elles ne causent de rechutes.

Ciblage d’IL1RAP dans l’immunothérapie contre la LAGC et la LMA pédiatique
Le lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC) est l’un des principaux types de lymphomes chez les enfants et les jeunes adultes, et la leucémie myéloïde aiguë (LMA) représente environ 20 % de toutes les leucémies pédiatriques. Bien que le pronostic de la LAGC et de la LMA se soit amélioré au cours des dernières décennies, les chimiothérapies couramment utilisées sont très toxiques et peuvent provoquer des mutations génétiques. Il est donc urgent d’élaborer de nouvelles options thérapeutiques, en particulier pour les enfants en pleine croissance atteints de cancers.
L’une des stratégies les plus prometteuses est l’immunothérapie, qui aide le système immunitaire du patient à combattre le cancer. Nous avons récemment identifié une protéine de surface, appelée « IL1RAP », fortement exprimée dans la LAGC et la LMA. Pour cibler IL1RAP par immunothérapie, nous avons mis au point une thérapie spécifique qui cible IL1RAP et entraîne la destruction des cellules tumorales dans les cultures cellulaires en laboratoire.
Grâce à cette subvention, nous développerons, testerons et améliorerons le ciblage d’IL1RAP, dans le but de mettre au point un traitement optimal contre la LAGC et la LMA pédiatriques.
Les subventions de fonctionnement de la SLLC, en partenariat avec d’autres organisations, financent la recherche qui peut changer de manière significative la compréhension, le diagnostic ou le traitement de la leucémie, du lymphome, du myélome, des syndromes myélodysplasiques et des néoplasmes myéloprolifératifs.

Caractérisation d’un nouvel inducteur de différenciation dans la LMA non LPA de l’adulte
La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est un cancer du sang caractérisé par une accumulation de cellules sanguines non fonctionnelles, au détriment de la production de cellules sanguines saines. Il existe de nombreux sous-types de LMA; parmi ceux-ci, la leucémie promyélocytaire aiguë (LPA) est le seul pour lequel un traitement assure la survie de quatre patients sur cinq. Le traitement en question s’appelle « thérapie de différenciation », dont le principe est d’aider les cellules leucémiques non fonctionnelles à se transformer en cellules matures, c’est-à-dire à se « différencier », comme le font habituellement les cellules normales. La forme promyélocytaire est présente chez seulement 10 % des personnes atteintes de la LMA.
Cette approche est très efficace, moins toxique, et elle « corrige » le comportement des cellules leucémiques pour qu’elles se différencient normalement. Nous avons étudié des milliers de molécules et en avons identifié une capable d’induire la différenciation pour des sous-types de LMA autres que la LPA. Pour la première fois, nous disposons d’une molécule de départ pour développer une thérapie de différenciation pour d’autres formes de LMA, avec l’espoir que cette thérapie soit aussi efficace que celle utilisée pour la LPA.
Nous désirons comprendre le fonctionnement de cette molécule afin de nous assurer qu’elle est sûre pour être approuvée et testée sur des patients, dans le but de mettre au point un médicament qui changera la donne pour le traitement de tous les sous-types de LMA.
Financé en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.

Suivi à distance en temps réel des receveurs de greffe allogénique de cellules souches
La greffe allogénique de cellules souches (provenant d’un donneur) est le meilleur exemple de thérapie cellulaire visant à guérir les cancers du sang tels que les leucémies. Si cette procédure offre une chance de guérison pour 70 % des patients, elle s’accompagne toutefois d’un taux de mortalité élevé lié à greffe. C’est pourquoi les patients sont contraints de rester à l’hôpital pendant plusieurs semaines après la greffe.
Toutefois, une étude récente a montré que les patients ayant reçu leur congé de l’hôpital aussitôt que possible après l’intervention obtenaient de meilleurs résultats que ceux gardés à l’hôpital sous observation étroite. Ces résultats sont très étonnants; mais en raison de contraintes logistiques, cette approche n’a été adoptée que dans quelques centres à travers le monde.
Notre projet teste un outil de suivi à distance sur le téléphone portable du patient. L’outil collige les renseignements rapportés par le patient et les données d’une montre intelligente; le personnel médical reçoit donc toute l’information nécessaire, et le patient peut rester chez lui. En collaboration avec des patients partenaires, nous évaluerons l’accueil réservé à une telle application, la fiabilité du signalement des symptômes et l’adhésion des patients à cet outil sur une longue période.
Financé en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.

Cibler la myristoylation pour traiter la LLC
La leucémie lymphoïde chronique (LLC), forme la plus courante de leucémie chez l’adulte, est une maladie incurable. Les thérapies ciblées telles que l’ibrutinib et le vénétoclax ont amélioré le taux de survie globale. Malheureusement, la maladie peut récidiver, auquel cas elle est souvent réfractaire aux médicaments, d’où le besoin pour de nouveaux traitements.
Notre équipe a récemment mis au point un nouveau médicament inhibiteur appelé PCLX-001 qui bloque l’altération des protéines de signalisation. L’efficacité du PCLX-001 dans le traitement de la LLC n’est pas connue. Dans ce projet, nous déterminerons d’abord le mécanisme de destruction des cellules de la LLC par le PCLX-001 et sa portée.
Ensuite, nous traiterons des cellules de la LLC résistantes aux médicaments avec le PCLX-001 seul, ou en combinaison avec des thérapies connues contre la LLC, afin de déterminer si le PCLX-001 est efficace sur les cellules de la LLC.
Enfin, nous évaluerons si le PCLX-001 peut être un traitement efficace contre la LLC et, si tel est le cas, nous jetterons les bases de futurs essais cliniques sur des personnes ayant une LLC réfractaire.
Financé en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.

Nouveau test pour suivre l’évolution du myélome et du système immunitaire chez les patients sous thérapie cellulaire
Le myélome est un cancer incurable. Bien que des progrès importants aient été réalisés dans les tests de laboratoire, avec l’évaluation de la maladie résiduelle mesurable (MRD, measurable residual disease) désormais possible, ces tests ne sont pas encore largement disponibles. La thérapie par lymphocytes T à récepteurs antigéniques chimériques (thérapie CAR-T, chimeric antigen receptor T cell therapy) est également très prometteuse. Toutefois, elle n’est pas encore financée pour les personnes atteintes d’un myélome au Canada, et présente des obstacles tels que la toxicité et un coût élevé.
Nous proposons de mettre au point un test de laboratoire innovant, très utile en regard du myélome et pour toute personne atteinte d’un lymphome ou d’une leucémie traitée par CAR‑T. Le Triple Test est conçu pour évaluer simultanément la MRD, la persistance des cellules CAR‑T dans l’organisme, et l’efficacité du système immunitaire.
Dans la première phase du projet, nous développerons et validerons le Triple Test au Centre des sciences de la santé de Kingston. Dans la seconde phase, le Triple Test sera intégré à l’essai TACtful, un essai clinique multicentrique de phase I du Groupe canadien des essais sur le cancer.
Cet essai clinique cible un nouveau type de thérapie cellulaire – cellules TAC-T – conçu pour réduire les effets secondaires observés avec la thérapie CAR-T, tout en maintenant les effets anti-myélome, à un coût potentiellement plus faible. Le Triple Test permettra de dépister les patients avant qu’ils ne participent à l’essai TACtful, de surveiller la MRD et de mesurer la persistance des cellules TAC-T dans l’organisme.
L’objectif est de rendre le Triple Test largement disponible afin de soutenir la recherche dans le cadre d’essais cliniques multicentriques supplémentaires, et d’en faire un test de référence facilement accessible pour les patients atteints d’un cancer du sang.
Financé en partenariat avec Myélome Canada.

Identification d’inhibiteurs pharmacologiques ciblant la protéine MYC-GPS dans la LLA‑T
Le traitement de référence pour la leucémie lymphoblastique aiguë à lymphocytes T (LLA-T) chez l’enfant passe par des inhibiteurs de topoisomérases; des médicaments ciblant les microtubules; et des corticostéroïdes administrés selon un schéma thérapeutique sur deux ans. Des taux de guérison de 90 % ne s’obtiennent que par une chimiothérapie lourde et prolongée chez les enfants, avec des conséquences immédiates et à long terme qui détériorent de façon irréversible leur qualité de vie. De plus, le pronostic de la LLA-T chez l’adolescent et l’adulte, ainsi que celui de la LLA-T en rechute à tous âges, est très sombre.
Les maladies réfractaires aux traitements laissent croire que la chimiothérapie actuelle ne parvient pas à cibler les vulnérabilités des cellules leucémiques. En cette époque marquée par la médecine de précision, nous proposons d’identifier des composés semblables à des médicaments qui dégradent la protéine dont l’expression anormale cause la leucémie, et dont la fonction n’est pas essentielle dans les cellules normales. Pour relever ce défi, nous nous appuyons sur notre expertise unique et convergente en matière d’approches multidisciplinaires de pointe en ce qui concerne les cellules souches sanguines normales et les cellules souches leucémiques dans la LLA-T.
Notre objectif est d’améliorer la chimiothérapie en identifiant des médicaments qui tuent efficacement les cellules souches leucémiques responsables des leucémies aiguës (LLA-T) et qui épargnent les cellules souches sanguines normales.
Financé en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.

L’édition génomique de précision des HLA pour étendre les greffes aux patients mal desservis
La plupart des personnes ayant une leucémie n’ont à leur disposition que des traitements peu efficaces qui tuent à la fois les cellules souches sanguines normales et les cellules leucémiques. En outre, la plupart des patients qui survivent souffrent d’effets secondaires importants et durables de leur traitement. Le traitement actuel le plus efficace consiste en une chimiothérapie agressive suivie d’une importante perfusion de cellules souches sanguines normales provenant d’un donneur « histocompatible », mais rarement apparenté.
Malheureusement, il est rarement possible de trouver un donneur compatible pour les patients canadiens atteints de leucémie qui sont d’origine autochtone ou asiatique, car leur bagage génétique est très différent de celui de la population canadienne d’origine caucasienne.
Pour surmonter cet obstacle, nous proposons de développer le potentiel d’une nouvelle technologie de pointe d’édition génomique qui modifiera de manière très spécifique et permanente les gènes clés des sources candidates, tout en conservant les principales propriétés régénératrices des cellules d’origine.
Financé en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.

Décoder la base immunitaire des syndromes lymphoprolifératifs post-transplantation
Nous visons à approfondir notre compréhension des syndromes lymphoprolifératifs post-transplantation (SLPT), des maladies peu étudiées qui résultent de la croissance anormale des globules blancs après une transplantation d’organe. Les patients, qui composent déjà avec des problèmes de santé complexes, peuvent être confrontés au fardeau supplémentaire du SLPT, un diagnostic potentiellement dévastateur. Un SLPT survient chez 2 à 5 % des receveurs de greffe et pose des défis importants pour les personnes ayant subi une transplantation.
Les traitements actuels, tels que la chimiothérapie, sont souvent mal tolérés en raison de problèmes de santé associés. Notre objectif est d’améliorer notre compréhension des fondements biologiques des SLPT afin d’ouvrir des pistes pour cibler précisément cette maladie.
Nous établirons le profil des échantillons de tissu tumoral des patients en utilisant des techniques innovantes pour déterminer les différences génétiques présentes au niveau de la cellule. Cette approche novatrice permettra, par exemple, d’identifier des types spécifiques de cellules immunitaires qui peuvent être enrichies chez les patients présentant une réponse plus ou moins bonne à la thérapie. Les connaissances acquises grâce à nos recherches pourraient ouvrir la voie à des traitements plus efficaces, et donc à de meilleurs résultats.
Financé en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.

Thérapie combinée CAR-DNT facilement accessible pour les hémopathies malignes lymphoïdes B
Notre équipe explore une approche innovante pour traiter la leucémie en utilisant des cellules immunitaires uniques appelées lymphocytes T doubles négatifs (DNT, double negative T cells). Ces cellules rares ont montré qu’elles pouvaient combattre la leucémie sans nuire aux tissus sains. Nous avons mis au point une technique permettant de cultiver ces cellules en grand nombre, rendant envisageable leur utilisation en thérapie.
Récemment, nous avons testé les DNT dans le cadre d’un essai clinique sur des patients atteints de leucémie qui n’avaient pas répondu à d’autres traitements. Les résultats sont prometteurs et montrent que la thérapie DNT est sûre et peut potentiellement prolonger la vie.
Notre nouveau projet associe les DNT à la technologie avancée des récepteurs antigéniques chimériques (CAR), couramment utilisée dans le traitement du cancer, pour créer des CAR‑DNT. Cette approche vise à améliorer les thérapies cellulaires CAR-T actuelles en les rendant plus accessibles et en réduisant les risques de rechute. Notre objectif est d’offrir un traitement facile d’accès qui donne de meilleurs résultats à long terme chez les patients atteints de leucémie.
Cette recherche explorera le potentiel des CAR-DNT en tant que stratégie de traitement innovante basée sur la technologie CAR, accessible et plus efficace pour les patients atteints de leucémie.
Financé en partenariat avec Transplantation et thérapie cellulaire Canada.

Cibler les niches de CSL : approche multiomique et d’apprentissage automatique
La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est un cancer très difficile à traiter, les cellules souches leucémiques (CSL) jouant un rôle essentiel dans la progression de la maladie et les rechutes. Alors que les chimiothérapies standard ciblent les cellules progénitrices leucémiques plus différenciées, l’hétérogénéité inhérente aux CSL empêche leur éradication complète, contribuant à la résistance aux médicaments et aux rechutes.
Ce projet vise à conduire une analyse multiomique des CSL, au niveau cellulaire, afin de mettre en évidence leur hétérogénéité. Grâce à l’intelligence artificielle, nous identifierons des combinaisons de médicaments possiblement efficaces contre divers types de CSL, et ces prédictions seront validées en laboratoire.
Financé en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.

Reconstitution immunitaire à long terme chez les receveurs de greffe allogénique de moelle osseuse
La greffe de cellules souches est un traitement essentiel des cancers du sang. Son principe est que le système immunitaire du donneur combatte le cancer, mais cela peut entraîner des complications telles que la maladie du greffon contre l’hôte (GvHD) et l’infection. Nous devons mieux comprendre l’évolution du système immunitaire après la greffe et son impact sur la santé à long terme.
Nous ne comprenons pas entièrement comment le système immunitaire des donneurs et des receveurs se comporte au fil du temps, et nous ne savons pas pourquoi les receveurs de greffe de cellules souches sont plus vulnérables plusieurs années après l’intervention. Notre objectif est d’examiner le système immunitaire des receveurs cinq ans ou plus après la greffe.
À partir d’échantillons de sang de donneurs et de receveurs, nous utiliserons des techniques avancées pour comprendre la constitution de leurs cellules immunitaires. Pour ce faire, nous étudierons diverses populations de cellules immunitaires et leurs fonctions afin d’évaluer le succès de la transplantation.
Cette étude révèlera les lacunes potentielles des réponses immunitaires après les greffes de cellules souches. Il est essentiel de comprendre ces enjeux – particulièrement en considérant les récents défis tels que la pandémie de COVID-19 –, car cela permettra d’améliorer le taux de survie des personnes atteintes de cancers du sang.
Financé en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.

Le récepteur IL-23 (IL-23R) intracellulaire régule la mitose et favorise la prolifération cellulaire de la LMA
Les cellules cancéreuses, y compris les cellules de la leucémie myéloïde aiguë (LMA), présentent généralement un nombre anormal de chromosomes. Cette anomalie du matériel génétique est à l’origine du cancer, mais elle crée également un stress pour la cellule cancéreuse lorsqu’elle doit se diviser. Les cellules cancéreuses trouvent des mécanismes pour s’y adapter et se diviser avec un nombre anormal de chromosomes.
L’IL-23R est le récepteur de la cytokine IL-23. Il est généralement situé à la surface des cellules immunitaires, mais nous avons découvert sa présence aussi à l’intérieur des cellules de la LMA et des cellules sanguines normales. À l’intérieur des cellules, ce récepteur aide les cellules leucémiques à se diviser.
Grâce à cette subvention, nous déterminerons comment l’IL-23R régule la division cellulaire, nous révèlerons de nouvelles informations sur le mode de division cellulaire dans la LMA et nous espérons valider l’IL-23R en tant que nouvelle cible thérapeutique pour un sous-ensemble de patients atteints de la LMA.
Financé en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.

Contourner la résistance à la lénalidomide dans le syndrome myélodysplasique avec délétion 5q
Environ 10 % des personnes atteintes du syndrome myélodysplasique (SMD), un cancer de la moelle osseuse, présentent une anomalie génique spécifique appelée délétion 5q, ou del(5q). Les patients atteints de ce type de SMD ont souvent besoin de transfusions sanguines, engendrant des répercussions négatives sur leur qualité de vie. Cet aspect est toutefois généralement amélioré grâce à un médicament appelé lénalidomide, grâce auquel la plupart des patients ne requièrent plus de transfusions pendant un certain temps. En revanche, la lénalidomide devient progressivement inefficace et aucun autre traitement n’est disponible actuellement.
Les données préliminaires indiquent que les cellules cancéreuses des patients atteints d’une SMD avec del(5q) qui sont résistantes à la lénalidomide présentent une signalisation hormonale excessive, liée à la croissance cellulaire. Il existe plusieurs médicaments offerts sur le marché qui peuvent bloquer cette signalisation (inhibiteurs de MEK, ou MEKi), mais aucun d’entre eux n’a encore été testé chez des patients atteints de SMD avec del(5q).
Nous souhaitons réaliser des études précliniques supplémentaires pour confirmer que ces médicaments (MEKi) fonctionnent également dans un environnement simulé de moelle osseuse (organoïde) ou in vivo (modèles murins), car ils n’ont été testés qu’en milieu in vitro jusqu’à présent. Ces études permettront aussi de confirmer quel médicament MEKi est le plus efficace et quel pourrait être le bon dosage.
Financé en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.
transferred to skip link location: 2024-subventions-de-recherche-sur-les-cancers-du-sang-pediatriques
transferred to skip link location: 2024-subventions-de-fonctionnement
transferred to skip link location: 2024-subventions-pour-medecins-chercheurs
transferred to skip link location: 2024-subventions-pour-la-qualite-de-vie-des-personnes-ayant-un-cancer-du-sang
La recherche sur la qualité de vie pose la question suivante : « Quelles sont les conséquences d’un diagnostic de cancer et de son traitement sur la vie générale du patient? » Elle prend en compte la santé physique, mais aussi la santé mentale, les relations sociales et la capacité à faire des choses agréables et nécessaires pour vivre pleinement. Ce financement permettra d’approfondir nos connaissances sur les défis auxquels sont confrontées les personnes ayant un cancer du sang et leur famille, ainsi que sur les possibilités d’améliorer leur qualité de vie tout au long de leur expérience du cancer.

Le programme PROSLEEP pour améliorer la qualité de vie après un cancer du sang
De nombreux adultes atteints d’un cancer du sang ont des problèmes de sommeil persistants, ce qui influe sur la gestion des symptômes, la tolérance à l’activité et la qualité de vie. Savoir reconnaître les personnes à haut risque permettrait de leur offrir des stratégies de pointe adaptées en matière d’éducation sur l’hygiène du sommeil, d’accompagnement à la relaxation et de soutien par des professionnels ou des pairs. C’est d’autant plus important que les médicaments couramment prescrits pour améliorer le sommeil en oncologie ne sont pas recommandés pour un usage prolongé.
Pour répondre à ce problème, le programme PROSLEEP a été récemment mis en place avec le soutien de la SLLC afin de documenter les habitudes de sommeil et leur impact sur la gravité des symptômes, les activités quotidiennes et la qualité de vie des survivants d’un cancer du sang. Jusqu’à présent, l’étude a porté sur 30 participants, dont le sommeil et les comorbidités ont été suivis à l’aide d’un actigraphe (un capteur généralement porté au poignet), d’un journal de bord et de questionnaires hebdomadaires.
Les participants souffrant de troubles de sommeil persistants ont suivi un programme personnalisé de deux semaines, encadré par des experts du sommeil – et par des patients partenaires formés, afin de démontrer sa faisabilité. Pour la proposition d’étude de suivi, 38 patients supplémentaires seront recrutés dans le but de vérifier la validité du programme et de mieux évaluer la satisfaction des participants à son égard. Les résultats seront présentés lors d’ateliers collaboratifs avec des cliniciens, des administrateurs et d’autres parties prenantes dans des lieux divers, ce qui offrira un aperçu de la faisabilité du programme en contexte réel.

Les cancers du sang chez les aînés d’origine sud-asiatique
De nombreux aînés d’origine sud-asiatique ont choisi de s’établir au Canada après avoir émigré de l’Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Sri Lanka ou du Népal. Les taux de cancer chez les aînés sud-asiatiques (65 ans et plus) sont en hausse. Il serait utile de comprendre comment les personnes d’origine sud-asiatique atteintes d’un cancer du sang prennent soin d’elles-mêmes en vieillissant. Ainsi, nous étudierons les moyens pris par les aînés sud-asiatiques de la Colombie-Britannique pour gérer leur cancer du sang.
Nous désirons connaître : 1) leur définition du concept « prendre soin de soi-même »; 2) la manière dont ils prennent soin d’eux-mêmes; et 3) leurs conseils et suggestions. Nous voulons en savoir plus sur la gestion de leur santé lorsqu’ils sont atteints d’un cancer du sang. Ce projet de recherche nous permettra d’aller à la rencontre de la communauté sud-asiatique du Canada et de rassembler de l’information pour mettre en place des soins adaptés à leur culture et à leur langue.

Améliorer la santé des femmes après une greffe allogénique de cellules souches
La greffe de cellules souches provenant d’un donneur (greffe allogénique) reste le meilleur traitement contre les cancers du sang tels que les leucémies. Malgré la disponibilité des donneurs et l’amélioration des taux de guérison grâce aux donneurs non apparentés et aux membres de la famille partiellement compatibles, la greffe allogénique reste associée à des effets secondaires importants à long terme, le plus notable étant la maladie chronique du greffon contre l’hôte (cGVHD).
La cGVHD, qui survient chez 30 % à 70 % des patients, est un dysfonctionnement du système immunitaire qui peut toucher tous les organes du corps, notamment les organes génitaux, et nécessite un usage prolongé de médicaments aux nombreux effets secondaires, telle la cortisone. Chez les femmes, la cGVHD peut entraîner un inconfort vulvovaginal, des pertes, des douleurs, et même un rétrécissement vaginal.
Il existe très peu de données sur l’incidence, les facteurs de risque, le tableau clinique et les répercussions sur la santé sexuelle de la cGVHD secondaire aux transplantations actuelles. Notre objectif est d’acquérir des connaissances sur l’atteinte vulvovaginale de la cGVHD en menant une étude prospective dans laquelle seront collectées des données sur d’autres enjeux importants chez les femmes – notamment la gestion de la ménopause, les infections génitales, la santé sexuelle et la qualité de vie.
Après la collecte de données fiables sur la cGVHD à localisation génitale, notre objectif à long terme est d’élaborer des lignes directrices à l’intention des médecins transplantologues, des gynécologues et des médecins de famille afin d’améliorer les soins offerts aux femmes canadiennes ayant reçu une greffe allogénique.
transferred to skip link location: 2024-immunotherapie-canadiennes-contre-le-cancer-clic-01
transferred to skip link location: 2024-soutien-aux-programmes-de-subvention-d-autres-organisations
La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) s’associe à BioCanRx pour aider les scientifiques canadiens à mener davantage d’essais cliniques sur la thérapie cellulaire CAR-T. Le réseau d’immunothérapie du Canada BioCanRx est un réseau de scientifiques, de cliniciens, d’intervenants dans le domaine du cancer, d’établissements universitaires, d’organisations non gouvernementales et de partenaires de l’industrie qui travaillent en collaboration afin d’accélérer le développement d’immunothérapies de pointe pour le bien des patients.

Essai clinique dirigé au Canada sur la thérapie CAR-T utilisant des cellules fabriquées au Canada pour traiter les leucémies et les lymphomes récidivants
La thérapie CAR-T utilise les cellules immunitaires (lymphocytes T) du patient pour repérer et éliminer les cellules cancéreuses. Cette procédure complexe requiert l’extraction des lymphocytes T du sang, puis leur modification génétique en laboratoire. Ces cellules modifiées sont ensuite réintroduites dans le système sanguin du patient où elles se multiplieront, puis repéreront et élimineront les cellules cancéreuses.
Jusqu’à maintenant, le Canada n’avait pas de laboratoires pour modifier ces lymphocytes T si importants. L’essai clinique de BioCanRx en immunothérapies du cancer dirigées par le Canada (CLIC-01) est unique, puisqu’il s’agit du premier essai pour développer et fabriquer des cellules CAR-T au Canada. L’essai CLIC-01, qui compte plus de 70 patients, a prouvé la possibilité de traiter des patients rapidement avec des cellules fabriquées au Canada et d’obtenir des réponses durables.
La prochaine étape consiste à ouvrir de nouveaux sites cliniques et laboratoires afin d’élargir l’accès à l’échelle nationale et de procéder à davantage d’essais de la thérapie CAR-T, l’objectif final étant d’obtenir une autorisation de mise en marché au Canada.
La Dre Kekre dirige l’essai clinique CLIC-01, qui traite des patients atteints d’un cancer du sang récidivant ou réfractaire. Dans cette phase d’expansion de l’essai, la Dre Kekre espère que le programme de recherche évoluera pour que plus de Canadiens, partout au pays, puissent avoir accès à cette thérapie novatrice pouvant sauver des vies.
La SLLC est un partenaire de cofinancement de l’essai clinique CLIC-01 de BioCanRx.
La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) est le partenaire financier de programmes de recherche d’autres organisations.

Définition de l’origine et des voies métaboliques des lésions ostéolytiques chez les patients atteints de myélome multiple
L’une des caractéristiques les plus courantes du myélome est son effet sur les os. Les plasmocytes anormaux (ou cellules myélomateuses) présents dans la moelle osseuse affectent l’os environnant, causant l’apparition de points faibles appelés « lésions lytiques » ou « lésions ostéolytiques ». Celles-ci entraînent un affaiblissement des os, une augmentation du risque de fractures, une diminution de la mobilité et des douleurs souvent intenses, chroniques et difficiles à gérer. Ainsi, les lésions ostéolytiques peuvent gravement compromettre les capacités fonctionnelles et l’indépendance des personnes touchées.
Les lésions ostéolytiques indiquent souvent une progression avancée de la maladie, et sont associées à un risque plus élevé de complications (notamment d’hypercalcémie et de compression de la moelle épinière) et à une prédisposition aux infections.
Elles peuvent également entraîner une anémie et une susceptibilité accrue aux saignements. L’élaboration de nouveaux traitements qui ciblent les processus de remodelage osseux est donc essentielle pour les personnes atteintes d’un myélome.
Les approches thérapeutiques novatrices pouvant inhiber la dégradation des os et favoriser leur formation peuvent prévenir les fractures et améliorer la gestion globale de la maladie.
Le Dr Kuchenbauer et son équipe cherchent de nouvelles solutions pour préserver la structure osseuse et prévenir les fractures. De tels traitements pourraient atténuer les complications, améliorer la réponse aux traitements du myélome et prolonger la survie.
Une meilleure compréhension des lésions ostéolytiques et la mise au point de nouvelles stratégies thérapeutiques s’annoncent très prometteuses pour l’amélioration des résultats et du bien-être général des personnes touchées par cette maladie difficile et complexe.
La SLLC est un partenaire de cofinancement de cette bourse de recherche Aldo Del Col de Myélome Canada.

Création de nanocorps engageurs bispécifiques pour le traitement du myélome multiple
Les personnes atteintes d’un myélome triple réfractaire (lorsqu’il y a absence de réponse aux agents immunomodulateurs, aux inhibiteurs du protéasome et aux anticorps anti-CD38) ont malheureusement un mauvais pronostic. La thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (thérapie CAR-T) est très prometteuse dans le traitement du myélome mais, malheureusement, son coût et sa complexité en limitent l’accessibilité, particulièrement au Canada.
Les anticorps bispécifiques peuvent cependant constituer une option de traitement plus accessible en offrant des temps d’attente plus courts et une plus grande flexibilité de dosage à un coût inférieur à celui de la thérapie CAR-T. Bien que les anticorps bispécifiques ciblant les cellules T (BiTE; teclistamab) aient été approuvés par Santé Canada en 2023 pour le traitement du myélome, son accès clinique est encore limité au Canada. Les anticorps bispécifiques ciblant les cellules tueuses naturelles (BiKE) pourraient jouer un rôle semblable aux BiTE, mais leur degré de toxicité pourrait être moins élevé. Cependant, ils sont pour le moment moins étudiés et moins connus.
Scott McComb, Ph. D, et son équipe de recherche ont une expertise bien établie dans l’identification des cibles du myélome et de nouveaux anticorps, de même que dans la mise au point d’immunothérapies.
Dans cette étude, les chercheurs proposent de générer de nouveaux « anticorps à domaine unique de lama » de grande qualité (appelés « nanocorps ») qui se lient solidement aux protéines exprimées sur les cellules myélomateuses. L’équipe utilisera ensuite ces nouveaux nanocorps pour générer de nouvelles molécules BiTE et BiKE afin d’évaluer leur capacité à induire la destruction du myélome en utilisant des cellules T ou des cellules NK. L’équipe a l’intention de transposer rapidement une ou plusieurs des nouvelles thérapies en vue d’essais cliniques au Canada.
La SLLC est un partenaire de cofinancement de cette bourse de recherche Aldo Del Col de Myélome Canada.

Comprendre la biologie et le devenir des jeunes patients atteints d’un myélome et traités par des thérapies modernes au Canada
Les jeunes patients atteints d’un myélome, tels que définis dans l’étude, sont des personnes âgées de 50 ans ou moins. Bien que le myélome soit dévastateur à tout âge, les jeunes font face à des difficultés uniques. Ils peuvent perdre un plus grand nombre d’années de vie active, puisque la maladie survient pendant les années les plus productives de leur vie, et la maladie, son traitement et ses répercussions ont un impact négatif sur leur famille.
On sait très peu de choses sur les caractéristiques cliniques et biologiques des jeunes au moment du diagnostic et sur l’influence de ces caractéristiques sur leur survie. Il existe actuellement peu de données dans la littérature scientifique sur les jeunes ayant un myélome qui suivent des traitements modernes, et il n’existe aucune donnée sur les jeunes Canadiens atteints d’un myélome. Par conséquent, la gestion optimale de la maladie demeure incertaine, car ces jeunes ont également tendance à être sous-représentées dans les essais cliniques.
En utilisant la base de données du Canadian Myeloma Research Group, le Dr Roy et son équipe analyseront rétrospectivement les données d’environ 530 jeunes patients. Les connaissances acquises dans le cadre de ce projet permettront d’aider les cliniciens canadiens à fournir des données précises sur la survie à leurs jeunes patients qui suivent des traitements modernes et de compiler des données essentielles pour concevoir d’éventuels essais cliniques utilisant de nouvelles thérapies cellulaires en vue de trouver un remède.
La SLLC est un partenaire de cofinancement de cette bourse de recherche Aldo Del Col de Myélome Canada.

Cibler PIKfyve pour le traitement du myélome multiple
Les taux de survie des personnes atteintes d’un myélome s’étant considérablement améliorés, celles-ci sont de plus en plus nombreuses à vivre plus longtemps et à jouir d’une meilleure qualité de vie. Ce fait est bien sûr extrêmement encourageant, mais la plupart d’entre elles finissent par rechuter en raison de la résistance aux médicaments. Deux défis urgents se profilent actuellement : trouver de nouvelles options de traitement et comprendre les mécanismes de résistance aux traitements afin de prévenir les rechutes ou de les surmonter.
Le Dr Stewart et son équipe ont travaillé à détecter des cibles vulnérables méconnues du myélome afin d’établir une nouvelle approche de traitement de la maladie. La kinase PIKfyve a été définie comme nouvelle cible thérapeutique. Parmi d’autres molécules, PIK-001, un très puissant inhibiteur de la kinase PIKfyve, a montré une activité antimyélome robuste dans des analyses préliminaires.
Dans cette étude, les chercheurs examinent de plus près la cytotoxicité (le degré auquel une substance peut causer des dommages à une cellule) de PIK-001 contre les cellules myélomateuses humaines, ils explorent des protocoles de combinaison avec des traitements connus du myélome et ils caractérisent les mécanismes de résistance à l’inhibition de la kinase PIKfyve.
Les données précliniques obtenues dans le cadre de cette étude serviront de base à la conception d’un essai clinique de phase 1 et permettront de poursuivre la mise au point de ces nouveaux puissants inhibiteurs de la kinase PIKfyve en vue d’obtenir les autorisations réglementaires nécessaires à leur utilisation clinique. Il s’agira d’un ajout important et prometteur à l’arsenal de traitements du myélome pour la communauté des personnes qui en sont atteintes.
La SLLC est un partenaire de cofinancement de cette bourse de recherche Aldo Del Col de Myélome Canada.
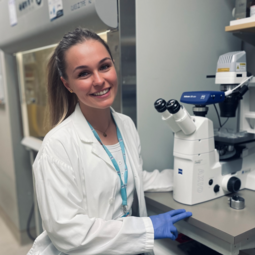
Étude de la résistance aux médicaments médiée par la niche des cellules souches leucémiques selon un modèle organoïde de moelle dérivé de cellules souches pluripotentes induites
Comme la plupart des cancers du sang trouvent leur origine dans la moelle osseuse, l’élaboration d’un modèle semblable à la moelle pouvant être étudié en laboratoire permettra aux chercheurs de mieux comprendre l’évolution des cancers du sang.
Le projet établira un « modèle organoïde physiologique de moelle osseuse dérivé de cellules souches pluripotentes induites », qui sera d’abord utilisé pour étudier les cellules souches leucémiques, avec l’objectif d’éventuellement étudier d’autres zones de développement des cellules leucémiques et d’autres cancers du sang, en vue de mieux comprendre l’origine des cancers du sang.
La SLLC est un partenaire de cofinancement de cette bourse de recherche au doctorat de la Société de recherche sur le cancer.

Étude de nouveaux composés antileucémiques découverts par l’entremise du criblage à haut débit de modèles humains de leucémies
La leucémie myéloïde aiguë, ou LMA, est un groupe de maladies génétiquement et biologiquement diverses qui sont difficiles à traiter et qui ont un mauvais pronostic. Dans le cas de la LMA pédiatrique, le manque d’échantillons de patients et le nombre restreint de cellules leucémiques contenues dans les échantillons nuisent à la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques.
Pour surmonter ces problèmes, l’équipe a collaboré avec d’autres chercheurs en vue d’obtenir plusieurs échantillons de LMA et, ainsi, de réaliser une analyse détaillée (criblage à haut débit) de ces cellules et d’identifier les molécules ayant une activité anti-LMA. Cette étude prometteuse a permis de distinguer plusieurs composés intéressants, et la détermination de leurs cibles potentielles et de leur fonctionnement pourrait mener à la mise au point de nouveaux traitements pour la LMA.
La SLLC est un partenaire de cofinancement de cette bourse de recherche au doctorat de la Société de recherche sur le cancer.
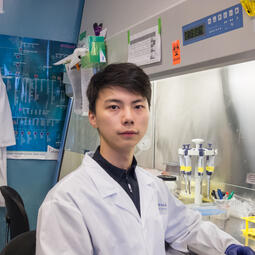
Thérapie par lymphocytes T progénitrices à récepteur antigénique chimérique (CAR-Pro-T) universelle contre le cancer
Le projet vise à développer une thérapie CAR-Pro-T universelle. À l’heure actuelle, la thérapie CAR-T utilise des lymphocytes T isolés du sang du patient, qui sont ensuite modifiés, puis réintroduits chez le patient. Il s’agit d’un processus long et coûteux dont l’application est limitée. L’équipe de recherche propose d’utiliser des cellules souches pluripotentes induites comme source de cellules pour la thérapie CAR-T. Ces cellules peuvent être modifiées en laboratoire et reprogrammées pour devenir des lymphocytes T, qui peuvent ensuite servir à la thérapie CAR-T. Ce processus éliminerait la nécessité d’utiliser les propres cellules du patient, surmontant ainsi plusieurs obstacles actuels à la thérapie CAR-T.
La SLLC est un partenaire de cofinancement de cette bourse de recherche au doctorat de la Société de recherche sur le cancer.
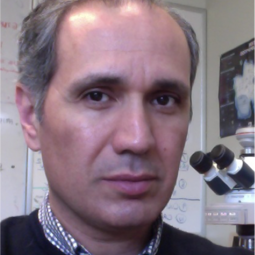
Développement d’un nouveau lymphocyte T à récepteur antigénique chimérique BCL2L1 blindé et d’un interactome immunisé aux tumeurs dans le myélome multiple
La résurgence des thérapies basées sur l’immunité et les progrès importants réalisés dans l’étude génomique des cellules individuelles ont permis d’obtenir des réponses au cancer sans précédent. Les personnes atteintes d’un myélome multiple bénéficient de la modification des lymphocytes T (CAR-T) et de la génération d’anticorps bispécifiques – deux processus qui donnent des résultats prometteurs, mais qui ne constituent pas encore un remède.
En outre, les causes de la résistance à l’immunothérapie restent pour la plupart inconnues. Pour pallier ce manque de compréhension et développer la prochaine génération de traitements immunothérapeutiques, comme les lymphocytes CART BCL2L1 blindés, l’équipe de recherche étudie le génome de l’environnement immunitaire (interactome), des cellules individuelles et des cellules de myélome multiple.
La SLLC est un partenaire de cofinancement de cette bourse de programme de recherche translationnelle de la Société de leucémie et lymphome (États-Unis).
Subventions de recherche – 2023
La recherche sur la qualité de vie pose la question suivante : « Quelles sont les conséquences d’un diagnostic de cancer du sang et des traitements sur la vie du patient? » Elle prend en compte la santé physique, mais aussi la santé mentale, les relations sociales et la capacité à faire des choses agréables et nécessaires pour vivre pleinement.
Ce financement permettra d’approfondir nos connaissances sur les défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes d’un cancer du sang et leur famille, ainsi que sur les possibilités d’améliorer leur qualité de vie tout au long de leur expérience du cancer. Les subventions 2023 pour la qualité de vie des personnes ayant un cancer du sang sont disponibles grâce au soutien de Steele Auto Group.

Cependant, il existe peu de recherches sur les difficultés liées au retour au travail après une greffe allogénique de cellules hématopoïétiques et seuls 50 à 60 % des survivants d’un cancer du sang reprennent le travail après ce traitement.
Cette étude vise à documenter le processus de retour au travail et à déterminer les besoins en matière de soutien des personnes ayant bénéficié d’une telle greffe.
Les résultats seront utilisés pour élaborer des stratégies, des contenus éducatifs et des recommandations pour le retour au travail en temps opportun afin d’améliorer la qualité de vie des patients.

Les adolescents et les jeunes adultes de 15 à 39 ans atteints d’un cancer du sang font face à des défis uniques en raison des traitements qui interrompent les processus de développement typiques.
Ils sont confrontés à différents défis : obstacles à la formation de leur propre identité et de leur indépendance, à la poursuite d’études supérieures et d’une carrière, et à l’acquisition de compétences sociales pour nouer des amitiés et des relations intimes.
Ces obstacles peuvent avoir des répercussions importantes sur leur bien-être mental et leur qualité de vie en général, et ce jusqu’à la fin de leurs jours.
Cette étude cherche à comprendre et à identifier les conséquences sur la santé mentale et les expériences des adolescents et des jeunes adultes atteints de cancers du sang.
Les résultats de cette étude contribueront à la sensibilisation et à la défense des besoins en santé mentale des adolescents et jeunes adultes atteints de cancers du sang à l’échelle provinciale et nationale, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.

Les PRO (« résultats rapportés par les patients ») sont des outils utilisés par les patients pour donner leur avis sur leur santé, leur qualité de vie et leur traitement. Les PRO électroniques (ePRO) sont utilisés pour consigner les symptômes liés au cancer et leur gravité.
Malheureusement, peu de recherches ont été menées sur l’approche de suivi ePRO pour les patients recevant une immunothérapie.
Notre équipe a développé une plateforme numérique, appelée V-Care, qui utilise les ePRO pour permettre aux patients atteints d’un cancer qui recoivent une immunothérapie d’envoyer des alertes à leur clinicien s’ils présentent des symptômes graves ou changeants.
Cette étude cherche à comprendre les symptômes qui peuvent prédire l’apparition des effets indésirables liés à l’immunothérapie et à tester l’utilité de la plateforme V-Care.
Les résultats seront utilisés pour aider les cliniciens à identifier les patients présentant un risque élevé de développer des effets indésirables liés à l’immunothérapie.

Le nombre d’enfants et d’adolescents qui survivent à un cancer du sang est en augmentation, mais la transition après le cancer comporte de nombreux défis lorsqu’ils se réadaptent à la maison et retournent à l’école.
Deux études récentes ont démontré que l’on n’accorde pas suffisamment d’attention aux défis en éducation auxquels est confrontée la population croissante d’enfants et d’adolescents ayant survécu à une hémopathie maligne.
Avec une équipe formée de survivants, de familles, de prestataires de soins de santé, de travailleurs sociaux, d’éducateurs et de chercheurs, cette étude vise à combler les principales lacunes en matière de connaissances et à élaborer un nouveau module de formation fondé sur des données probantes et consacré aux plans de soins pour la vie après le cancer.
L’objectif de cette étude est d’améliorer la réintégration à l’école des enfants et des adolescents ayant survécu à une hémopathie maligne et de les aider à réaliser leur plein potentiel scolaire.

Les personnes qui reçoivent un diagnostic de NMP peuvent vivre longtemps, mais elles peuvent être très malades et souffrir de complications de la maladie, ce qui affecte grandement leur qualité de vie.
Les adolescents et les jeunes adultes atteints d’un néoplasme myéloprolifératif font face à un ensemble unique de défis physiques, sociaux et émotionnels qui sont mal compris, car il existe peu d’études de recherche dans ce domaine.
Cette étude cherche à comprendre les symptômes et l’impact d’un néoplasme myéloprolifératif sur la vie quotidienne des adolescents et des jeunes adultes qui en sont atteints, par rapport aux patients plus âgés, ainsi qu’à développer un outil sur la qualité de vie pour guider les personnes qui en prennent soin.
C’est la première fois que les questions liées à la qualité de vie sont étudiées dans la population des adolescents et des jeunes adultes atteints de NMP.
Cette étude pourrait modifier la façon dont nous traitons les adolescents et les jeunes adultes (identification des marqueurs pour une intervention précoce, personnalisation de la thérapie), ce qui permettra aux patients non seulement de vivre plus longtemps, mais aussi de vivre mieux.
Il est important de noter que les résultats et les nouvelles ressources développées serviront non seulement aux adolescents et jeunes adultes atteints de NMP, mais aussi à une plus grande population de jeunes atteints de cancers du sang au Canada – et dans le monde entier.
Les subventions pour cliniciens-chercheurs encouragent les cliniciens spécialistes débutants en milieu clinique à poursuivre une carrière dans la recherche sur les cancers du sang. Cette occasion vise à favoriser l’acquisition de compétences et l’indépendance nécessaire pour mener des recherches sur les cancers du sang en laboratoire, dans un environnement clinique ou dans un milieu mixte.

Cette étude porte sur la compréhension d’un type de cellule leucémique qui apparaît au début de la chimiothérapie. Ces cellules évoluent d’une manière qui leur permet d’échapper à l’effet de la chimiothérapie et de survivre, demeurant une source de leucémie dans la moelle osseuse qui peut provoquer la réapparition de la maladie.
Selon certaines données, il est possible de cibler ces cellules leucémiques en recourant à l’immunothérapie. L’étude analysera ces cellules pour comprendre l’effet de ce traitement sur ces dernières et pourquoi il est efficace.
Les résultats serviront à déterminer la meilleure façon de cibler ces cellules au moyen de l’immunothérapie et le moment optimal pour le faire.
La SLLC est heureuse de s’associer à la Société de recherche sur le cancer (SRC) pour cofinancer dix projets sur le cancer du sang dans le cadre du concours de subventions de fonctionnement 2022 de la SRC.
La Société de recherche sur le cancer est un organisme national sans but lucratif dont la seule mission est de financer la recherche sur tous les types de cancer, afin de contribuer à l’avancement des recherches scientifiques visant à prévenir, à diagnostiquer et à traiter la maladie.
La leucémie lymphoblastique aiguë à cellules T (LLA-T) représente environ 15 % de toutes les leucémies infantiles et 25 % des leucémies chez les adultes. Bien que la chimiothérapie ait amélioré le traitement de la LLA-T, particulièrement chez les enfants, la résistance à ce traitement est un facteur majeur dans la rechute des patients et est associée à un mauvais pronostic ainsi qu’à des décès importants. Par conséquent, une meilleure compréhension de la manière dont les cellules leucémiques de la LLA-T échappent à la chimiothérapie et y deviennent résistantes permettra probablement d’améliorer l’efficacité des traitements.
Notre équipe a récemment identifié une molécule appelée GPR52 qui s’exprime dans les cellules leucémiques de la LLA-T et qui peut être un facteur essentiel dans la résistance de ces cellules à la chimiothérapie. En bloquant cette molécule, nous avons réussi à détruire les cellules leucémiques en plus grand nombre par la chimiothérapie. Dans le cadre de cette proposition, nous définirons le rôle de la GPR52 dans le développement de la résistance aux médicaments des cellules leucémiques de la LLA-T et nous étudierons les mécanismes impliqués dans cette résistance.
Nous déterminerons également s’il est efficace de bloquer la molécule GPR52 pour éradiquer les cellules leucémiques LLA-T chez les patients ayant suivi une chimiothérapie. Ces études ont le potentiel de révéler une nouvelle cible thérapeutique dans la LLA-T. Ainsi, l’inhibition de la GPR52 par des inhibiteurs existants combinée à la chimiothérapie pourrait être une nouvelle stratégie permettant d’améliorer les effets de ce traitement de la LLA-T, d’en réduire la toxicité et d’éviter la rechute des patients.

La leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) est un cancer du sang qui touche principalement les enfants. Bien que le pronostic soit généralement bon, le traitement entraîne des effets indésirables multiples qui affectent de manière importante la qualité de vie de ces jeunes patients.
L’asparaginase pégylée (PEG-ASNase) est un médicament essentiel dans le traitement de la LLA. Il s’agit d’une protéine bactérienne qui se modifie en s’attachant au polyéthylène glycol (PEG), un polymère synthétique. Malheureusement, la PEG-ASNase entraîne chez certains patients une fabrication d’anticorps qui diminuent l’efficacité du traitement tout en augmentant les effets indésirables. Certains de ces anticorps reconnaissent le PEG sur la protéine.
Le PEG est très couramment utilisé dans les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques, y compris dans les vaccins à ARNm contre la COVID-19. Cela signifie que certaines personnes pourraient développer des anticorps anti-PEG avant même de recevoir la PEG-ASNase.
Les mécanismes à l’origine de la production des anticorps reconnaissant le PEG ne sont pas bien compris. Ce projet de recherche vise à étudier la manière dont la PEG-ASNase déclenche la production d’anticorps anti-PEG et à évaluer comment le médicament entre en réaction croisée avec les anticorps anti-PEG préexistants. Parallèlement, nous fabriquerons une nouvelle génération de PEG-ASNase qui ne possède pas les limitations du traitement actuel. En conclusion, ce projet aboutira à une meilleure prise en charge des patients atteints de LLA présentant des anticorps anti-PEG préalablement au traitement et contribuera au développement d’une nouvelle catégorie de traitements plus sécuritaires.
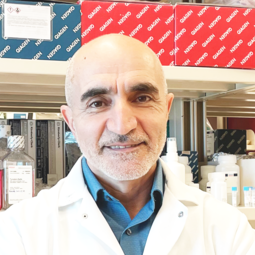
Les cellules T tueuses naturelles sont un élément essentiel du système immunitaire et participent à la lutte contre le cancer. Elles sont en mesure de fournir une protection en raison de leur capacité à cibler et à tuer les cellules tumorales. Cependant, les qualités anticancéreuses des cellules T tueuses naturelles peuvent diminuer progressivement, phénomène qu’on appelle généralement « épuisement des cellules T ». Les cellules T tueuses naturelles épuisées présentent à leur surface des protéines spécifiques qui les empêchent de tuer les cellules tumorales.
Récemment, nous avons découvert une protéine spéciale, nommée CD160, à la surface des cellules T tueuses naturelles présentes dans le sang et la moelle osseuse des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC). Nous avons constaté que les cellules malignes de ces patients sécrètent constamment une autre protéine (IL-16), qui est responsable de la présence accrue de CD160. Cette dernière agit comme un frein sur le système immunitaire. Enfin, nous avons noté que la présence accrue d’IL-16 était associée à un mauvais pronostic chez les patients atteints de LLC.
Par conséquent, nous proposons de mener d’autres études sur un groupe plus important de patients afin de confirmer nos observations précédentes. Nous utiliserons également un modèle de LLC en vue d’évaluer le potentiel d’une approche thérapeutique qui ciblerait la protéine sécrétée (IL-16) par les cellules malignes. Nous croyons que ces études nous permettront de proposer une nouvelle cible immunothérapeutique éventuelle dans la LLC et, possiblement, les autres cancers du sang.

Le taux de survie après cinq ans de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) est de 21 %. La LMA est difficile à traiter, car elle a déjà atteint un stade complexe et agressif au moment du diagnostic. Cette maladie est causée par des cellules souches sanguines ayant acquis de nombreuses mutations supplémentaires en plus de celles d’origine, qui sont responsables du stade précoce de la maladie, ou « préleucémie ».
Par conséquent, il est crucial d’employer un traitement capable de cibler les quelques changements génétiques précoces précédant le développement de la LMA. Notre objectif est d’étudier le syndrome myélodysplasique (SMD) préleucémique afin de lever le voile sur ces facteurs clés.
L’un des processus susceptibles de favoriser le développement des cellules souches sanguines préleucémiques est l’épissage alternatif, qui peut mener à la production de différentes protéines à partir de la même information génétique. Nous avons découvert que les changements dans l’épissage de la protéine MBD1 peuvent entraîner le développement et l’établissement du SMD.
L’équipe de recherche fera un suivi des changements préleucémiques suscités par le mauvais épissage de la protéine MDB1 et évaluera le potentiel thérapeutique d’une approche visant à réduire la quantité de MBD1 dans les cellules des patients atteints de SMD. Nous déterminerons également les changements biologiques déclenchés par les problèmes d’épissage de la MBD1 afin de définir les processus qui pourraient répondre aux traitements médicamenteux.
Bien qu’elles soient essentielles à une intervention rapide et à la prévention de la LMA, nos connaissances des cibles thérapeutiques aux stades précoces du SMD et de la LMA sont limitées. L’identification des protéines MDB1 résultant de l’épissage alternatif est un facteur déclencheur clé qui nous apportera des informations cruciales sur les biomarqueurs préleucémiques et les possibilités de traitement, et qui apporte beaucoup d’espoir pour le diagnostic et l’intervention précoces de la LMA.

La greffe d’un organe est un événement majeur dans la vie des patients ayant des organes défaillants. Par exemple, une greffe d’organe peut éliminer le besoin de recourir à la dialyse pour les personnes souffrant d’une maladie rénale au stade terminal, ou même sauver la vie de ceux vivant avec des maladies respiratoires ou cardiaques au stade terminal.
Malheureusement, une greffe d’organe s’accompagne de l’obligation de prendre un traitement immunosuppresseur à vie qui entraîne des complications, y compris des infections et un risque accru de tumeurs. La croissance anormale de tumeurs déclenchée par un type de globules blancs spécifiques, appelés lymphocytes, est d’une importance toute particulière. On parle de « syndrome lymphoprolifératif post-greffe (SLPG) ».
Le SLPG est une maladie grave qui comporte un risque de décès précoce. En outre, les patients peuvent avoir besoin d’une chimiothérapie toxique, qui est souvent mal tolérée en raison de comorbidités et d’une immunosuppression préexistante. Par conséquent, il existe un besoin pressant d’améliorer les traitements du SLPG.
Malheureusement, la nature de cette maladie n’est pas bien comprise. Dans le cadre de cette proposition, nous effectuerons une analyse approfondie de la composition d’échantillons de tissus cancéreux du SLPG à l’aide d’une nouvelle technologie de haute résolution qui permet d’étudier ces échantillons cellule par cellule. Nous découvrirons les fondements biologiques de cette maladie peu commune, ce qui ouvrira la porte à la conception de nouveaux traitements.
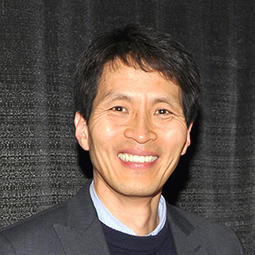
Le LTAI est un lymphome T agressif causé par les « lymphocytes T auxiliaires » normaux qui défendent notre organisme contre les pathogènes. Bien qu’inadéquate, la chimiothérapie est le seul traitement contre le LTAI. Par conséquent, le traitement de cette maladie requiert des médicaments plus appropriés et puissants.
Notre équipe de recherche a récemment inventé des manières de distinguer les cellules tumorales malignes des lymphocytes T auxiliaires normaux présents dans la tumeur. Fait important, l’équipe de recherche a recueilli des preuves que ces cellules tumorales malignes dépendent d’une enzyme appelée « EZH2 », qui détermine le type de gène à activer ou désactiver. À l’aide de modèles de recherche du LTAI, nous nous pencherons sur la façon dont EZH2 favorise la croissance des cellules tumorales du LTAI et sur les gènes impliqués dans ce processus. En cas de réussite, notre étude permettra de mettre au jour des cibles thérapeutiques prometteuses pour soigner les patients atteints de LTAI.

Bien que la plupart des vaccins contre le cancer basés sur l’utilisation des cellules dendritiques (type de cellules immunitaires) reposent exclusivement sur la dégradation des antigènes par l’immunoprotéasome, la contribution fonctionnelle du thymoprotéasome (TPr) à l’immunité reste floue. Par conséquent, nous avons cherché à comprendre si les cellules stromales mésenchymateuses (CSM) pouvaient se comporter comme des cellules présentatrices d’antigène suivant l’expression de novo du TPr. Après avoir confirmé leur capacité à traiter et à présenter des peptides dérivés de protéines exogènes solubles, nous avons évalué leur effet protecteur contre le lymphome et avons découvert qu’elles peuvent, en effet, déclencher des réponses antitumorales. Cependant, leur mode d’action reste obscur et implique une interaction avec deux importantes cellules immunitaires endogènes. L’objectif de cette étude est de mieux comprendre en quoi les cellules MSC-TPr ont besoin de cellules endogènes pour induire une réponse immunitaire afin que nous puissions fabriquer de nouveaux vaccins contre le lymphome ayant une efficacité accrue pour les patients atteints d’un cancer.

Les globules blancs peuvent reconnaître et détruire les tissus cancéreux. Cependant, chez les patients atteints de cancer, ils perdent leur capacité à reconnaître les tumeurs. Nous avons mis au point des méthodes de génie génétique permettant de redonner aux globules blancs leur capacité à attaquer les tumeurs chez les patients atteints de cancer.
Bien que notre méthode actuelle soit efficace, le processus de fabrication est coûteux et chronophage, ce qui limite l’accès à ce traitement prometteur. Pour accroître son accessibilité et réduire les coûts, nous avons développé des globules blancs qui peuvent être administrés de façon immédiate par les pharmacies d’hôpital. Néanmoins, la programmation des globules blancs pour qu’ils attaquent les tumeurs cancéreuses présente encore des difficultés.
Dans le cadre de ce projet, nous améliorerons les méthodes d’ingénierie utilisées pour fabriquer des globules blancs à disposition immédiate des patients et pour établir de nouvelles méthodes chimiques permettant de programmer les globules blancs afin qu’ils attaquent les tumeurs. Par ces efforts, nous visons à élaborer un traitement flexible et dynamique pouvant être utilisé à grande échelle contre de nombreux cancers.
Les leucémies aiguës regroupent des cancers du sang agressifs et dévastateurs. Malgré l’amélioration des traitements, les rechutes sont fréquentes et mènent inévitablement au décès.
Les avancées récentes indiquent que les cancers du sang sont liés à des « cellules de soutien » spécialisées dans la moelle osseuse. Néanmoins, nous ne savons pas s’il est possible d’améliorer le traitement de ces maladies en bloquant les interactions entre les cancers du sang et leur système de soutien.
À l’aide de technologies de pointe, ce projet examinera les effets du retrait des cellules sanguines cancéreuses de leur environnement de soutien sur la progression de la leucémie et les rechutes. Les chercheurs pensent que ces études aboutiront principalement à de nouveaux traitements ciblant ces cancers dévastateurs et amélioreront ainsi le pronostic des patients.
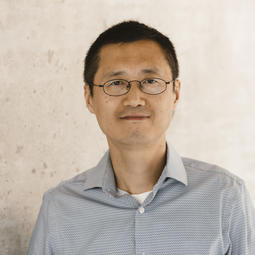
Chaque année, la leucémie myéloïde aiguë (LMA) touche un million de personnes dans le monde et cause 150 000 décès. De 25 % à 30 % des patients atteints de LMA présentent une mutation du gène FLT3. Ces mutations, appelées FLT3-ITD, sont généralement à l’origine d’un risque extrêmement élevé de rechute chez les patients atteints de ce cancer.
Actuellement, la méthode standard pour détecter la présence de la mutation FLT3-ITD chez les patients consiste à utiliser une technique de laboratoire appelée « réaction en chaîne de la polymérase (PCR) ». Cependant, les tumeurs sont habituellement composées d’une population diversifiée de cellules présentant des constitutions génétiques différentes. La PCR permet uniquement d’obtenir l’information génétique des cellules dans leur ensemble et ne peut pas fournir l’information précise contenue dans chaque cellule individuelle.
Une telle ambiguïté peut entraîner un pronostic inexact ou même empêcher de choisir les meilleures options de traitement. Pour s’attaquer à ces enjeux, notre équipe de recherche a décidé d’utiliser une technologie de séquençage de cellules uniques de pointe afin de déterminer la constitution génétique exacte de chaque cellule individuelle. Cette nouvelle technologie permet également de mesurer la proportion de marqueurs protéiques particuliers à la surface des cellules et de fournir des informations supplémentaires sur les cellules tumorales. Elle a le potentiel de définir précisément le lignage cellulaire des cellules tumorales lors de la progression du cancer et de contribuer à améliorer les pronostics et la sélection des traitements optimaux.
Les subventions de fonctionnement de la SLLC financent des projets qui permettent de mieux comprendre les cancers du sang et d’améliorer les options de traitement.
La SLLC est fière de financer 15 subventions de fonctionnement en partenariat avec la Société de recherche sur le cancer.

La présente étude vise à comprendre comment cette enzyme est utilisée par les cellules leucémiques, et à chercher des façons de la cibler et d’en modifier le fonctionnement au moyen de molécules semblables à des médicaments.
Les résultats obtenus pourraient contribuer à des travaux évolutifs axés sur la mise au point de traitements antileucémiques et sur l’amélioration des taux de survie.

La LMA est très difficile à traiter, et moins de 30 % des patients qui sont touchés par ce cancer survivent à long terme. Chez les patients âgés, le taux de survie est encore plus faible.
Il a été récemment démontré qu’un nouveau médicament appelé « Venetoclax » peut améliorer les taux de survie globale, même chez les patients âgés. Soulignons toutefois que, dans bien des cas, la leucémie devient résistante à ce traitement ou réapparaît.
La présente étude cherche à comprendre comment les cellules adipeuses situées près des cellules leucémiques protègent les cellules de LMA contre des traitements médicamenteux et entraînent une pharmacorésistance.
Les résultats obtenus feront avancer l’utilisation d’autres médicaments qui bloquent l’activité de ces cellules adipeuses pour prolonger l’effet de Venetoclax, l’objectif étant d’améliorer le traitement des patients atteints de cette maladie dévastatrice.

Même si des méthodes de génie génétique hautement efficaces ont été conçues pour rétablir cette capacité, elles sont très coûteuses en raison du besoin de créer génétiquement les globules blancs de chaque patient.
La présente étude concevra de nouvelles méthodes pour créer des traitements à base de globules blancs qui peuvent être prêts à l’emploi ou produits en série, l’objectif étant de surmonter l’obstacle que représentent les coûts élevés de leur fabrication pour chaque patient.
Les résultats obtenus pourraient mener à des méthodes peu coûteuses, utilisées non seulement pour produire des traitements à base de globules blancs, mais aussi pour les rendre accessibles à tous les patients qui pourraient en tirer profit.

Les mutations du gène IKZF3 entraînent des changements touchant la protéine IKZF3 dans les cellules B immatures, ce qui cause la leucémie.
Il a été démontré que le médicament « lénalidomide » élimine la protéine IKZF3 dans les cellules cancéreuses.
La présente étude évaluera l’effet de la lénalidomide sur les cellules cancéreuses qui présentent une mutation du gène IKZF3 par rapport aux cellules dont le gène IKZF3 est normal, afin de déterminer quels gènes sont contrôlés par la protéine IKZF3.
Les résultats obtenus serviront à déceler les faiblesses présentes dans les cellules cancéreuses, qui peuvent être ciblées au moyen d’autres médicaments administrés en association avec la lénalidomide.

Les médicaments qui exploitent la capacité du système immunitaire des patients à combattre le cancer se sont avérés prometteurs dans le traitement d’autres types de tumeurs, mais des résultats similaires n’ont pas été obtenus chez les patients atteints du LDGCB.
La présente étude vise à comprendre comment la protéine eIF4E, qui est hyperactive en raison du LDGCB, contribue à l’évolution du lymphome.
Il se peut que les résultats obtenus suggèrent des moyens d’inhiber l’activité de la protéine eIF4E en cas de LDGCB, l’objectif étant de réduire la croissance des cellules de lymphome et d’améliorer les taux de survie.

La présente étude évaluera l’efficacité et l’innocuité de l’acide tranexamique (TXA; un médicament qui empêche la dissolution des caillots) pour voir s’il peut atténuer le risque ou la gravité des saignements chez ces patients.
Si les résultats obtenus montrent qu’on peut réduire en toute sécurité la fréquence des saignements, cette approche changera la façon dont les médecins prodiguent des soins aux patients atteints du SMD ou de la LMA dans le monde.

Le macrophage, une cellule du système immunitaire, est en mesure d’éliminer les cellules cancéreuses en les ingérant et en les digérant.
Le rituximab est une immunothérapie qui utilise les macrophages pour tuer les cellules de lymphome. Ce médicament s’est avéré nettement plus efficace dans le traitement de plusieurs formes de lymphome. Toutefois, les lymphomes qui ne répondent plus au traitement et qui réapparaissent demeurent une grande préoccupation.
La présente étude vise à comprendre comment certaines cellules de lymphome évitent d’être ingérées par les macrophages lors d’un traitement par le rituximab, et à déterminer comment améliorer la capacité des macrophages à capturer les cellules cancéreuses.
Les résultats obtenus fourniront de nouvelles stratégies axées sur la création de polythérapies qui améliorent l’efficacité du rituximab, précisément chez les patients qui ont cessé de répondre au traitement ou qui font une rechute.

La chimiothérapie standard peut entraîner des effets secondaires graves, comme des cancers secondaires et des maladies cardiaques. C’est pourquoi la mise au point de traitements personnalisés est essentielle pour améliorer les taux de survie et diminuer les effets secondaires.
La présente étude examinera la constitution génétique des cellules cancéreuses et leur interaction complexe avec les cellules stromales, qui jouent un rôle important dans le soutien tissulaire et la réponse immunitaire.
Les résultats obtenus grâce à la recherche nous permettront de mieux comprendre le lymphome hodgkinien et de définir de nouvelles cibles thérapeutiques.

Dans plus de 50 % des cancers (y compris de nombreux lymphomes et d’autres cancers du sang), on observe des changements génétiques qui entraînent une activité accrue d’une protéine appelée « cMYC » et qui sont liés à de mauvais résultats chez les patients.
La cMYC et une autre protéine, appelée « MYSM1 », agissent ensemble dans les cellules cancéreuses. L’organisme peut être fortement protégé contre le lymphome si l’action normale de la MYSM1 est inhibée dans les cellules où il y a une activité accrue de la cMYC. Une telle inhibition retarde la progression du cancer et prolonge la survie.
La présente étude analysera la MYSM1 : comment la perte d’activité de la MYSM1 protège l’organisme contre le lymphome et entraîne la formation d’inhibiteurs de la MYSM1 à petites molécules (médicaments qui bloquent l’action de la MYSM1).
Les résultats obtenus feront avancer les travaux qui visent l’utilisation de la MYSM1 comme cible pharmacologique chez les patients atteints du lymphome cMYC positif, l’objectif étant d’améliorer le traitement et les taux de survie dans cette population.

Les antigènes spécifiques de la LMA (ASL) sont des protéines qui se trouvent uniquement sur les cellules de LMA. Selon de fortes données probantes indirectes, certains ASL créent spontanément une réponse immunitaire antileucémique chez des patients.
La présente étude évaluera le potentiel thérapeutique de différents ASL et jettera les bases d’un vaccin à ARN et à base d’ASL contre la LMA.
En plus d’indiquer quels sont les meilleurs ASL à inclure dans un vaccin à ARN et à base d’ASL, les résultats obtenus fourniront les données nécessaires à la tenue d’un essai clinique visant à déterminer l’innocuité, les effets secondaires et la meilleure dose d’un tel vaccin.

En présence de LMA, les cellules leucémiques subissent une reprogrammation métabolique qui change le métabolisme cellulaire. On entend par « métabolisme » l’ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans une cellule. Ces réactions produisent l’énergie et le matériel nécessaires aux cellules pour croître, se multiplier et rester en santé.
Des travaux récents ont montré que certains composés qui ciblent ces différences métaboliques arrivent à tuer les cellules leucémiques sans tuer les cellules normales.
La présente étude vise à mieux comprendre la façon dont la reprogrammation métabolique contribue à la destruction des cellules de LMA.
Les résultats obtenus grâce à cette recherche nous aideront à mieux comprendre les processus liés à la mort des cellules leucémiques. Ils pourraient grandement améliorer la vie des patients qui sont touchés par la LMA et qui, à l’heure actuelle, ont des options thérapeutiques limitées et des taux de survie plus faibles.

L’ibrutinib appartient à une classe de médicaments appelée « inhibiteurs de la BTK ». Ces médicaments bloquent les signaux qui indiquent aux cellules cancéreuses de croître. Malheureusement, les inhibiteurs de la BTK ne guérissent pas la LLC, car d’autres signaux peuvent prendre le relais et entraîner une résistance au traitement.
La présente étude déterminera l’effet de l’anakinra (un médicament qu’on utilise couramment pour traiter l’arthrite et qui peut bloquer l’un de ces autres signaux) sur les cellules sanguines cancéreuses traitées par des inhibiteurs de la BTK, et si d’autres signaux contribuent à la résistance au traitement.
Les résultats obtenus serviront à justifier les essais cliniques sur l’ibrutinib et l’anakinra, qui peuvent aider à accroître les taux de guérison chez les personnes ayant la LLC ou d’autres cancers du sang.

Si nous voulons concevoir de meilleurs traitements, il est important de comprendre comment et pourquoi les cellules cancéreuses s’adaptent à un traitement anticancéreux et y deviennent résistantes.
La présente étude porte sur un mécanisme important par lequel les cellules cancéreuses reprogramment l’environnement immédiat pour survivre et échapper aux effets du traitement.
Tirées des résultats obtenus, les connaissances et découvertes axées sur les nouveaux biomarqueurs ou cibles thérapeutiques nous aideront à trouver des façons plus efficaces de traiter la LMA et de combattre les rechutes.

La présente étude cherche non seulement à comprendre comment les CSL sont vulnérables et comment elles peuvent être ciblées, mais aussi à connaître le rôle unique que joue la protéine PLK1 dans le fonctionnement des CSL.
Les résultats obtenus serviront à définir les vulnérabilités qui peuvent être ciblées sur le plan thérapeutique, afin qu’on puisse surmonter la pharmacorésistance et mettre au point des médicaments et des associations médicamenteuses plus sûrs et plus efficaces, qui visent à améliorer les résultats des patients ayant la LMA.
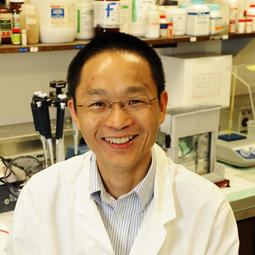
Il existe un besoin pressant d’élaborer de meilleurs traitements contre le SMD et la LMA, car le taux de survie à cinq ans est considérablement moins élevé pour la LMA (23 %) que pour l’ensemble des leucémies (61 %).
Les mutations du gène DDX41 sont associées au SMD et à la LMA.
La présente étude identifiera et validera les cibles qui tuent de façon sélective les cellules leucémiques porteuses du gène DDX41 muté.
Les résultats obtenus entraîneront la mise au point de meilleurs traitements selon des cibles pharmacologiques potentielles pour la LMA et le SMD porteurs du gène DDX41 muté.
Le programme de subventions pour les découvertes sur les cancers du sang, mené en partenariat avec la société américaine Leukemia and Lymphoma Society, finance des travaux de chercheurs canadiens sur les cancers du sang. Ce programme soutient la recherche innovatrice de pointe axée sur les découvertes, visant à comprendre les propriétés, mais aussi les vulnérabilités, des cancers du sang et à faire progresser les traitements contre cette maladie. Ce programme s’adresse aux chercheurs universitaires reconnus pour appuyer la recherche fondamentale, dès les étapes préliminaires, qui peut mener à des progrès dans le traitement et la guérison des cancers du sang.

Les traitements offerts aux personnes ayant une leucémie myéloïde aiguë (LMA) sont généralement efficaces. Cependant, il y a habituellement une rechute. Il y a donc un besoin pressant de développer de nouveaux traitements.
Les résultats préliminaires obtenus par l’équipe de recherche de la Dre Jones démontrent que lors d’une rechute, les cellules de LMA dépendent d’une molécule appelée glutathion qui modifie leur fonctionnement. De plus, il semble que l’inhibition du glutathion n’affecte pas les cellules sanguines normales, ce qui suggère qu’il pourrait être une cible pour un nouveau traitement contre la LMA dont les effets secondaires seraient moins sévères.
Dans le cadre de ce projet, l’équipe de recherche vise à comprendre et à cibler les propriétés spécifiques aux cellules de leucémie myéloïde aiguë lors d’une rechute, ce qui pourrait mener à la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques pour venir en aide aux personnes qui font face à cette situation.
En cette époque marquée par la mise au point de médicaments ciblés et immuno-oncologiques chez l’adulte, on constate que très peu de ces nouveaux remèdes efficaces ont été adaptés pour traiter les cancers du sang chez l’enfant. Bien que des progrès aient été réalisés dans ce domaine, les taux de guérison demeurent faibles pour certains types de cancer du sang et les traitements traditionnels sont associés à des effets importants à long terme.
Ces projets visent à remettre en question le paradigme actuel des traitements des cancers du sang pédiatriques en vue de combler les lacunes et d’améliorer les résultats.

Le traitement contre les SHIMO nécessite une greffe de la moelle osseuse, qui est associée à de nombreux risques et complications potentielles, surtout chez les patients ayant une DC et un nombre inférieur de cellules immunitaires. Ces patients courent un risque beaucoup plus élevé de leucémie.
Le développement du sang chez le poisson-zèbre est similaire à celui de l'être humain, mais il est plus rapide. Le poisson-zèbre est donc un modèle idéal à utiliser lorsqu’on étudie la DC et la façon dont elle évolue en leucémie.
La présente étude vise à examiner les effets du gène de la DC chez les poissons-zèbres, afin de nous aider à comprendre comment il touche la production du sang et cause la leucémie.
Les résultats obtenus pourront être utilisés pour identifier des médicaments capables d'influencer les anomalies sanguines et d'interrompre le développement de la leucémie.
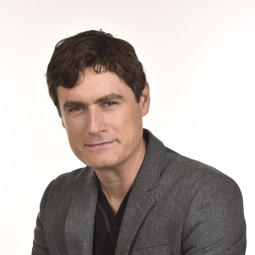
Même lorsqu’une réponse est obtenue, la chimiothérapie nécessaire au traitement entraîne plusieurs effets secondaires qui ont des conséquences à long terme sur le développement et la santé de l’enfant.
Ces cas de leucémie sont causés par des changements précis dans le code génétique des cellules sanguines, qui touchent la production de cellules sanguines normales et provoquent, en conséquence, la formation de protéines anormales. Le système immunitaire pourrait reconnaître ces protéines comme étant étrangères (puisqu’elles ne sont pas naturellement produites par nos cellules).
La présente étude vise à identifier ces protéines anormales et à les utiliser comme cibles pour traiter la leucémie infantile au moyen de cellules immunitaires au lieu d’une chimiothérapie toxique.
Les résultats obtenus peuvent valoir pour les patients qui n’ont pas répondu à une chimiothérapie. À terme, l’immunothérapie cellulaire qui cible les cellules leucémiques pourrait remplacer la chimiothérapie toxique.

Notons aussi que le pronostic est très sombre, tant chez les adolescents et les adultes ayant une leucémie lymphoblastique aiguë à cellules T (LLA-T) que dans les cas de LLA-T en rechute, quel que soit l’âge. La chimiothérapie actuelle n’a pas réussi à maîtriser les cellules leucémiques et endommage les cellules saines.
À l’ère de la médecine de précision, nous pouvons faire mieux. Nous pensons qu’un patient touché par un cancer du sang échangerait volontiers un traitement de chimiothérapie de deux ans contre un vaccin thérapeutique.
La présente étude identifiera des protéines appelées « antigènes spécifiques de tumeurs », qui sont seulement présentes à la surface des cellules leucémiques et qui peuvent être ciblées directement.
Les résultats obtenus ouvriront la voie à la médecine de précision à son meilleur, en se basant sur la capacité unique du système immunitaire à déclencher une réponse hautement spécifique, dirigée contre des cibles qui se trouvent exclusivement sur les cellules leucémiques, tout en épargnant les cellules normales.
En partenariat avec la Leukemia and Lymphoma Society, organisme américain affilié, nous octroyons des subventions dans le cadre du programme de recherche translationnelle pour permettre aux chercheurs de propulser la recherche sur les traitements et les remèdes contre les cancers du sang, du laboratoire à l’amélioration des soins. Dans le cadre de ce programme, nous finançons des recherches inédites et prometteuses visant à trouver des applications cliniques à des connaissances biomédicales de base afin d’aider les personnes atteintes d’un cancer du sang.

Bien qu’une greffe de moelle osseuse puisse traiter, voire guérir les cancers du sang, son application est encore limitée par un risque de complication auto-immune potentiellement mortelle appelée maladie chronique du greffon contre l’hôte. Cette complication survient lorsque le système immunitaire du donneur attaque les tissus sains de l’hôte.
Grâce à l’expertise de l’équipe canadienne ABLE (Applied Biomarkers in Late Effects of Children and Adolescents with Cancer) et aux données recueillies par celle-ci, l’équipe de recherche pourra déterminer dans quelle mesure le prédicteur de risque pédiatrique de la maladie chronique du greffon contre l’hôte et le classificateur de diagnostic peuvent être utilisés avec les données relatives aux greffes de cellules souches hématopoïétiques chez les adultes de 18 à 60 ans.
L’équipe de recherche utilisera une approche complexe pour comprendre ce qui provoque l’apparition de la maladie chronique du greffon contre l’hôte chez les adultes pour arriver à en réduire l’incidence.

Les lymphomes à cellules B constituent le groupe le plus important de cancers du sang nouvellement diagnostiqués en Amérique du Nord. Malgré les avancées importantes dans le domaine des traitements, une grande partie des patients font face à une maladie récidivante ou réfractaire. Le développement de traitements plus efficaces et personnalisés est donc un besoin urgent qui n’a pas été encore comblé.
L’équipe de recherche du Dr Steidl a découvert qu’une altération génétique dans une voie qui régularise des aspects importants de la fonction immunitaire du corps, la voie NF-kB non canonique, est présente dans de nombreux lymphomes à cellules B. Cette découverte suggère que ces altérations pourraient être ciblées par de nouveaux traitements.
Dans le cadre de ce projet, l’équipe de recherche identifiera les mutations génétiques liées à la voie, définira les faiblesses dans la voie et procèdera à des tests de combinaison d’immunothérapies.
Subventions de recherche – 2022
La pandémie de COVID-19 a contrecarré les activités normales des chercheurs en investigation et en formation. Ces subventions uniques donneront un élan à la recherche sur le cancer du sang qui a marqué une pause durant la pandémie.

La leucémie du nourrisson touche les enfants de moins d’un an et son taux de survie est médiocre, principalement en raison de la toxicité des traitements actuels. La leucémie du nourrisson se doit souvent à des anomalies du gène de la lysine méthyltransférase 2A (KMT2A), présent sur le chromosome 11. Le chromosome se clive dans la section comprenant le gène KMT2A et s’attache à des gènes (MLLT3 et MLLT1) sur d’autres chromosomes, entraînant ainsi des fusions. Certains patients qui présentent des fusions dans le gène KMT2A avec des mutations supplémentaires dans la lysine-méthyltransférase 2C (KMT2C) développent la maladie plus rapidement.
Au cours de cette étude, l’équipe s’appuiera sur des modèles de poisson-zèbre présentant des mutations du gène KMT2A pour vérifier si la fusion KMT2A-MLLT3 ou KMT2A-MLLT1 a une incidence sur la formation du sang et si elle accélère la progression de la leucémie. Les chercheurs procéderont au dépistage des médicaments en ciblant les principales voies de la maladie afin de découvrir de nouveaux traitements potentiels, efficaces et sûrs, pour ce groupe de personnes vulnérables.

Les syndromes myélodysplasiques (SMD) sont un type de maladie sanguine associée à une issue défavorable en raison d’une susceptibilité accrue du patient aux infections et de la production de cellules sanguines anormales. Pire encore, un patient sur trois atteint d’un SMD développe une maladie secondaire mortelle, la leucémie myéloïde aiguë (LMA). Il n’existe à ce jour aucun moyen de prédire quelles personnes ayant un SMD risquent de progresser vers une LMA ni aucune mesure clinique pour la détecter ou la prévenir. L’ignorance du processus pathologique au niveau cellulaire explique en grande partie cette situation.
Un type de médicament, appelé « agent hypométhylant », a déjà permis d’obtenir des résultats encourageants, quoique temporaires, chez les personnes ayant un SMD et une LMA. Cependant, les nombreux effets non spécifiques de ces médicaments affectent l’expression de centaines de gènes à la fois, sans que l’on connaisse leur rôle dans la maladie ou leurs effets sur le patient.
La détermination des régions précises de l’ADN qui régulent un ensemble réduit et spécifique de gènes impliqués dans la SDM et son évolution vers la LMA fournirait les connaissances nécessaires pour mettre au point un type de médicaments à longue durée d’action et comportant moins d’effets secondaires, comme ce fut le cas pour d’autres cancers. La présente étude a pour objectif de localiser les sections de l’ADN et les gènes qu’elles contrôlent en tant que nouvelles cibles très spécifiques pour mettre au point des traitements entièrement nouveaux destinés aux personnes atteintes de SMD et de LMA.

L’hématopoïèse clonale de signification indéterminée (CHIP, sigle anglais) désigne la présence de cellules sanguines porteuses de mutations associées à la leucémie, en l’absence de toute pathologie hématologique. Les personnes porteuses d’une CHIP ont un risque nettement supérieur de développer des cancers du sang, notamment une leucémie aiguë, par rapport aux autres. Il peut s’écouler parfois plusieurs années entre la détection d’une CHIP et le diagnostic d’un cancer du sang. Cette découverte ouvre la possibilité extraordinaire d’interventions pour prévenir les cancers du sang. L’atteinte d’un tel objectif passe d’abord par la compréhension des différences de comportement qui existent entre les cellules sanguines normales et mutées. À partir de ces connaissances, il sera alors possible de concevoir des interventions efficaces et sûres.
L’une des mutations les plus courantes de la CHIP se trouve dans un gène appelé « TET2 ». L’équipe de recherche du Dr Chan a récemment découvert que les cellules sanguines présentant des mutations du gène TET2 dépendent plus d’une hormone, la thrombopoïétine (TPO), pour leur développement et leur survie, que les cellules sanguines normales. Cette découverte laisse entrevoir un possible blocage de la TPO pour détruire sélectivement les cellules sanguines mutées. Comme ces études ont été réalisées sur cellules artificielles, il faut maintenant en confirmer les résultats sur des cellules humaines. Lors de ce projet, les chercheurs vérifieront si les cellules sanguines humaines présentant la mutation du gène TET2 sont également plus dépendantes de la thrombopoïétine. Advenant une confirmation, on sera alors en mesure d’élaborer une approche potentielle pour éliminer la CHIP et, ultimement, prévenir les cancers du sang.
Lauréat 2022 du prix de reconnaissance spécial des TUAC

Ce projet vise à développer à long terme un nouveau système de modélisation largement applicable pour prédire la réponse des personnes ayant la LMA aux nouveaux traitements. La recherche se concentrera sur un modèle simulant le problème généralisé de récidive, généralement mortelle, d’une maladie après une réponse initiale au traitement. Dans l’immédiat, le but est de développer un système qui imite les cellules de patients, atteints de LMA résistante au traitement, après exposition à un traitement standard partiellement efficace.
Au cours de cette première série d’études, grâce à une nouvelle approche puissante, les chercheurs caractériseront les sous-types de cellules de LMA dans les échantillons de patients. Ils compareront alors leurs résultats avec les observations de laboratoire, avant et après l’exposition au traitement.
Les résultats permettront de valider cette approche pour l’utilisation future de ce modèle afin de trouver des traitements pouvant prévenir les rechutes ultérieures en cas de résistance, par opposition à l’élimination incomplète des cellules sensibles au traitement. Cette étape débouchera sur la création de nouveaux moyens permettant d’anticiper, de caractériser et de concevoir des méthodes d’élimination des types de cellules de la LMA considérées comme résistantes.

Ce projet vise la découverte des médicaments pour cibler les rares cellules à l’origine de l’échec du traitement de la leucémie, plus précisément les cellules souches leucémiques. Ces dernières entretiennent la LMA chez le patient et agissent un peu comme des cellules souches normales, mais elles sont à la « racine » du cancer. Pour obtenir une guérison, il faut les éliminer.
La rémission de la LMA chez l’enfant comme chez l’adulte exige des traitements extrêmement intenses et toxiques. Dans le cas de l’enfant, ils risquent de nuire à son développement en entraînant une dysfonction cardiaque à long terme, des problèmes de fertilité et des cancers secondaires plus tard dans la vie. En dépit de ces traitements agressifs, on n’obtient pas une réponse chez la majorité des patients, ou bien la leucémie revient plus tard. Pour améliorer les résultats et réduire la toxicité des traitements, il faut de toute urgence trouver de nouveaux remèdes.
Les chercheurs ont recensé 15 composés susceptibles d’éliminer sélectivement les cellules souches leucémiques. Ils vont valider l’efficacité des meilleurs de ces composés contre ces cellules sur un ensemble plus large d’échantillons de LMA et en tester la toxicité. Ils parviendront ainsi à sélectionner les meilleurs composés pour étude et développement ultérieurs.

Le traitement de référence pour la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules T (LLA-T) chez l’enfant passe par des inhibiteurs de la topoisomérase, des médicaments ciblant les microtubules et des corticostéroïdes administrés selon un schéma thérapeutique sur deux ans. Des taux de guérison de 90 % ne s’obtiennent que par une chimiothérapie lourde et prolongée chez les enfants, avec des conséquences immédiates et à long terme qui détériorent de façon irréversible leur qualité de vie. En outre, le pronostic s’avère très sombre chez les adolescents et les adultes atteints de LLA-T, ainsi que lors des rechutes, quel que soit l’âge. Les cas de résistance au traitement laissent croire que la chimiothérapie actuelle ne parvient pas à cibler les vulnérabilités des cellules leucémiques.
En cette époque marquée par la médecine de précision, l’étude vise à découvrir les antigènes spécifiques des tumeurs à cibler pour déclencher une réaction immunitaire contre ces antigènes, absents des cellules T normales et des autres types de cellules normales. Les travaux proposés ouvrent la voie à la médecine de précision à son meilleur, en partant de la capacité unique du système immunitaire de déclencher une réponse qui détecte spécifiquement les antigènes des cellules leucémiques, en épargnant les cellules normales.
La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est un cancer du sang agressif et très difficile à traiter. Une chimiothérapie à fortes doses, souvent accompagnée d’une greffe de cellules souches, permet d’obtenir une guérison, mais ce traitement ne convient pas à de nombreuses personnes d’âge avancé ou atteintes d’autres problèmes de santé.
La connaissance des altérations spécifiques de l’ADN au sein des cellules de LMA a conduit au développement d’inhibiteurs spécifiques des protéines modifiées, en obtenant des réponses prometteuses, notamment pour les personnes ayant d’autres pathologies ou en rechute. Toutefois, ces réponses, généralement de courte durée, aboutissent invariablement à l’apparition d’une résistance au traitement.
Les données préliminaires de l’équipe de recherche indiquent que, dans les cellules de LMA, la résistance au traitement se doit à l’activation d’un facteur précis, appelé « facteur d’initiation eucaryote 4A » (eIF4A), qui favorise l’expression de plusieurs protéines prosurvie. En outre, elle a découvert que le traitement par un inhibiteur du facteur eIF4A réduit le fardeau de la LMA et renforce l’effet d’autres traitements connus.
En partant de ces résultats, les chercheurs caractériseront dans ce projet le mécanisme d’action de l’inhibition du facteur eIF4A et testeront l’efficacité de nouvelles associations thérapeutiques avec des inhibiteurs du facteur eIF4A. Ils cherchent une nouvelle façon de traiter la LMA pour améliorer les thérapies actuelles et prévenir la résistance au traitement.

La protéine c-MYC est un important régulateur de l’expression génique, et les changements génétiques conduisant à l’augmentation anormale de son activité surviennent dans bon nombre de cancers, notamment les lymphomes. Ces lymphomes, difficiles à traiter, ont un pronostic défavorable pour les patients.
Une étude précédente financée par la SLLC indique une coopération entre la c-MYC et une autre protéine et enzyme appelée « MYSM1 » qui régule l’expression des gènes dans les cellules cancéreuses. En outre, on a établi que la perte de MYSM1 retarde la progression du lymphome lorsque la c-MYC est hyperactivée. Cette découverte constitue une validation solide pour le ciblage de la MYSM1 dans les cellules cancéreuses comme nouvelle thérapie en cas de lymphomes c-MYC positifs.
L’immunothérapie révolutionne le traitement du cancer en clinique. Il est important de noter que la MYSM1 est un important régulateur de l’expression des gènes non seulement dans les cellules cancéreuses, mais aussi dans les cellules immunitaires. Cependant, on ignore son rôle dans l’immunité antitumorale. Au cours de cette étude, les chercheurs évalueront les effets du ciblage de la MYSM1 sur les fonctions des cellules immunitaires et l’immunité antitumorale dans des modèles de lymphomes c-MYC positifs. Il s’agit d’une étape essentielle pour la poursuite du développement translationnel de leur recherche – afin d’établir la MYSM1 comme une cible pharmacologique pour les lymphomes c-MYC positifs.

Le Dr Paige et son équipe de recherche ont commencé à traiter des personnes atteintes de leucémie avec une nouvelle forme d’immunothérapie avant le début de la pandémie de COVID-19. Dans cette forme d’immunothérapie, les cellules leucémiques, provenant d’un patient, sont modifiées pour sécréter une molécule appelée « interleukine 12 » (IL-12). L’IL-12 est un puissant stimulateur immunitaire : il est si puissant qu’il ne peut être injecté directement. Les efforts mondiaux portent par conséquent sur la recherche de moyens moins toxiques d’introduire l’IL-12 sur le site même où la cellule leucémique rencontre les cellules du système immunitaire.
L’équipe a obtenu un grand succès en parvenant à ce que la cellule leucémique le fasse dans les modèles expérimentaux. Pour ce faire, elle a traité les cellules leucémiques du patient avec un vecteur viral pour introduire le gène de l’IL-12. On réinjecte ensuite ces cellules leucémiques modifiées chez le même patient où elles semblent déclencher une réponse immunitaire contre la leucémie. Une fois activées, les cellules du système immunitaire se passent de l’IL-12 et sont en mesure de tuer les autres cellules leucémiques du patient. Jusqu’à présent, les chercheurs ont traité six personnes lors d’un essai clinique de phase I destiné à tester l’innocuité d’une telle approche. Ils prévoient en traiter six autres pour terminer cet essai.

L’ibrutinib appartient à la classe des médicaments appelés « inhibiteurs de la TKB » utilisés comme nouveau traitement prometteur dans les cancers du sang. Malheureusement, ces médicaments à eux seuls ne suffisent pas à guérir les patients. Le groupe du Dr Spaner a découvert qu’une protéine appelée « IL-10 » tue les cellules cancéreuses du sang en présence d’ibrutinib. Néanmoins, ce médicament diminue les taux d’IL-10 chez les patients, et s’avère être un talon d’Achille pour les inhibiteurs de la TKB.
Dans ce projet, le Dr Spaner examinera les modalités d’action de l’IL-10 sur les cellules cancéreuses du sang en présence d’ibrutinib. Il vérifiera également l’innocuité et l’efficacité d’une perfusion simultanée d’IL-10 et d’ibrutinib pour traiter les cancers du sang. Dans le cadre de ce projet, on étudiera les cellules cancéreuses de personnes ayant la leucémie lymphoïde chronique (LLC).
Les résultats devraient permettre de valider l’association d’ibrutinib et d’IL-10 dans le traitement de la LLC. Cette approche vise à augmenter les taux de guérison de la LLC et de nombreuses autres formes de cancer.

Le lymphome folliculaire est un cancer des ganglions lymphatiques à croissance lente, qui reste incurable. Il peut évoluer spontanément vers une forme plus agressive de lymphome requérant une chimiothérapie. Les mutations de certains gènes sont fréquentes dans les lymphomes folliculaires, mais la manière dont ces gènes mutés interfèrent avec la fonction cellulaire normale reste mal connue.
Pour étudier le fonctionnement de ces gènes mutés dans les cellules humaines, le groupe de recherche les introduira dans des cellules normales de ganglions lymphatiques obtenues à partir des biopsies de patients. Les chercheurs testeront les effets des gènes mutés dans ces cellules de biopsie à l’aide d’un nouveau type de test (une méthode d’investigation). Il s’agit de cultiver les cellules en laboratoire sous forme d’organes miniatures, ou « organoïdes », pour recréer plus exactement les conditions d’un ganglion lymphatique dans le corps humain.
L’équipe testera un nouveau concept selon lequel des mutations génétiques spécifiques modifient l’ADN de la cellule en provoquant une réparation défectueuse des ruptures naturelles des brins d’ADN, ce qui conduit à une expression incontrôlée des gènes mutés. En sachant précisément comment ces gènes modifient l’ADN de la cellule, les chercheurs seront en mesure de corriger le problème et de rétablir les mécanismes de réparation normaux de la cellule. Ces travaux contribueront à la mise au point de nouveaux traitements directement applicables, car ils ont été testés dans des cellules provenant des patients eux-mêmes.
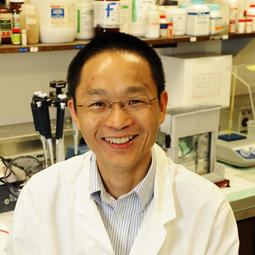
Les syndromes myélodysplasiques (SMD) forment un ensemble de cancers du sang et de la moelle osseuse. Dans le cas des SMD, la moelle osseuse ne produit pas suffisamment de cellules sanguines saines. Environ 30 % des personnes atteintes de SMD développent une leucémie myéloïde aiguë (LMA).
Le traitement des SMD ou de la LMA repose sur des chimiothérapies par azacitidine et cytarabine, deux médicaments utilisés depuis plus de 40 ans. Cependant, le faible taux de survie requiert d’urgence la mise au point de traitements plus efficaces.
Les mutations du gène DDX41 sont associées aux SMD et à la LMA, la mutation R525H étant la plus fréquente chez les patients. Récemment, le groupe de recherche a découvert que la protéine DDX41-R525H affecte la fonction cellulaire en entraînant une activation excessive du système immunitaire inné, avec des implications dans l’apparition et la progression du cancer. L’équipe de recherche s’est donc lancée dans le développement d’inhibiteurs spécifiques de la protéine R525H.
Les chercheurs essaieront de trouver de nouvelles molécules qui tuent sélectivement les cellules leucémiques en ciblant la DDX41. Les résultats pourraient déboucher sur un médicament puissant ciblant la DDX41 dans le traitement des SMD et des LMA.
Les enjeux liés à la qualité de vie des personnes touchées par un cancer du sang n’ont pas été aussi étudiés que d’autres aspects des soins. Les traitements entraînent dans leur sillage une foule de conséquences médicales et non médicales qui varient selon l’âge, le sexe, le genre, l’ethnicité, le type de cancer du sang et les soins prodigués. Le financement vise à améliorer la qualité de vie des Canadiens ayant un cancer du sang. La recherche sur cet aspect a le potentiel de changer la donne et de réduire le fardeau de la maladie pour les personnes atteintes, les survivants et les proches aidants.

Il peut être difficile pour les hématologues de prédire le moment où leur patient se rapproche de la mort. Par conséquent, les discussions sur les soins de fin de vie ont parfois lieu trop tard, ce qui peut avoir une incidence sur la qualité de ces soins.
Afin de mieux soutenir les personnes ayant un cancer du sang et leurs familles aux prises avec cette situation, les chercheurs mettront à l’essai un outil d’intelligence artificielle qui s’est avéré capable de prédire le moment où les personnes atteintes de toutes formes de cancers ont le plus de risques de mourir. Dans le cadre de cette étude, l’outil d’intelligence artificielle servira à repérer les personnes ayant un cancer du sang qui sont les plus à risque. Par la suite, l’équipe soignante entamera des discussions à propos des soins de fin de vie à l’aide d’un guide de conversations sur les maladies graves et les patients seront interrogés sur les moyens d’améliorer le soutien qu’ils reçoivent. En fin de compte, le repérage rapide des personnes à haut risque, l’utilisation du guide de conversations, l’amélioration de la qualité de vie et le perfectionnement des marqueurs de fin de vie grâce à la rétroaction des patients permettront à l’équipe soignante de mettre au point une approche des soins de fin de vie qui répond mieux aux besoins des personnes ayant un cancer du sang et de leurs familles.
En partenariat avec la Société canadienne du cancer

Des perturbations du sommeil et une fatigue persistante sont fréquemment rapportés par les patients après la fin de leur traitement contre un cancer du sang. Un sommeil de mauvaise qualité a une incidence sur les activités diurnes d’une personne, mais aussi sur sa qualité de vie. L’étude PROSLEEP est la première à explorer en profondeur la question du sommeil en lien avec la fatigue et la qualité de vie chez les personnes ayant récemment reçu un traitement contre un cancer du sang. Dans le cadre de cette étude, l’équipe de chercheurs observera le cycle de repos et d’activités des sujets. Les personnes souffrant de problèmes de sommeil persistants bénéficieront d’outils et de stratégies visant à améliorer la qualité de leur sommeil. Les résultats de l’étude contribueront à perfectionner ces outils et ces stratégies en vue d’un futur essai clinique contrôlé et randomisé.
En partenariat avec la Société canadienne du cancer

Les personnes ayant un lymphome qui font une rechute après leur traitement ou qui n’entrent pas en rémission (lymphome réfractaire) réagissent mal à la chimiothérapie standard. Bien que la greffe autologue de cellules souches ait longtemps été le traitement de choix, la thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) est maintenant la nouvelle norme de soins pour les personnes ayant un lymphome à cellules B récidivant ou réfractaire.
Cette étude vise à déterminer les avantages en matière de survie pour ces patients et l’impact de ces traitements sur leur qualité de vie, ce qui pourrait éclairer la prise de décisions concernant le traitement et les services de soutien. Les commentaires des personnes qui ont reçu une greffe autologue de cellules souches ou une thérapie CAR-T pour traiter un de ces deux types de lymphome aideront les chercheurs à évaluer les effets de ces traitements sur la qualité de vie des adultes qui en ont bénéficié. L’analyse des résultats apportera un nouvel éclairage sur la qualité de vie à long terme de ce groupe de patients, ce qui contribuera à l’élaboration d’interventions pour le dépistage précoce des personnes à haut risque et de mesures de soins de soutien.
En partenariat avec la Société canadienne du cancer

Le myélome multiple et le lymphome non hodgkinien indolent (qui évolue et se propage lentement) sont des cancers du sang incurables. Les personnes atteintes de ces maladies doivent faire face à de nombreux symptômes et à une mauvaise qualité de vie à différents stades de leur expérience du cancer.
Les chercheurs utiliseront un modèle dynamique pour prédire les résultats à différents moments du parcours des patients. Ce modèle évoluera grâce à la participation des patients, des aidants et des fournisseurs de soins de santé. Le but de cette étude est de récolter de l’information qui servira à mener des discussions pertinentes et à planifier les besoins futurs liés au cancer et, ultimement, à améliorer la qualité de vie pour ce groupe de personnes dans l’avenir.
L’étude mettra à l’essai un nouveau moyen de prédire la progression de ces cancers et se penchera notamment sur :
la survie;
la capacité d’effectuer les tâches liées à un mode de vie indépendant;
l’apparition de douleurs modérées à sévères;
la dépression;
le bien-être général.

Les personnes qui ont besoin d’une greffe allogénique de cellules souches (cellules provenant d’un donneur) pour traiter une leucémie ou un lymphome doivent d’abord subir un traitement agressif avant de recevoir cette greffe.
Elles ressentent donc des effets secondaires physiques et psychologiques dévastateurs pendant l’intervention et dans les années qui suivent. Pour beaucoup d’entre elles, le fait de vivre à plusieurs heures des centres de traitement et de greffe ne fait qu’aggraver la situation, car elles doivent gérer seules des effets secondaires débilitants.
Dans le cadre de cette étude qualitative, la Dre Pituskin et son équipe souhaitent en apprendre plus sur l’expérience des personnes qui reçoivent une greffe allogénique lorsqu’ils ont accès à une application de soins et au soutien téléphonique d’experts en soins infirmiers, en exercice et en nutrition. L’objectif est de déterminer le type de soins le plus utile et le meilleur moment pour l’offrir avec l’aide de personnes qui ont des connaissances concrètes à ce sujet.
En partenariat avec la Société canadienne du cancer

Les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui ont survécu à un cancer du sang ont un risque élevé de souffrir de divers problèmes de santé longtemps après la fin de leur traitement. C’est pourquoi ils doivent faire l’objet d’un suivi étroit pendant plusieurs années afin que tout problème de santé potentiel puisse être détecté et traité.
Pour qu’ils aient accès aux meilleurs soins possibles, ces jeunes patients sont dirigés vers un ou plusieurs fournisseurs de soins de santé. À l’heure actuelle, cette transition des soins ne fait pas l’objet de recherches particulières et il n’existe aucune définition claire des critères de réussite. Dans le cadre de ce projet, une équipe constituée de patients, de médecins et de chercheurs travaillera à définir ce que représente une transition de soins réussie chez les jeunes survivants du cancer du sang. Les résultats de ces travaux serviront à améliorer les soins qu’ils reçoivent, mais aussi les résultats qui en découlent, tels que leur qualité de vie.
Les subventions pour cliniciens-chercheurs encouragent les spécialistes débutants en milieu clinique à poursuivre une carrière dans la recherche sur les cancers du sang. Cette occasion vise à favoriser l’acquisition de compétences et l’indépendance nécessaire pour mener des recherches sur les cancers du sang en laboratoire, dans un environnement clinique ou dans un milieu mixte. Cette subvention est offerte en partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

Le lymphome à cellules B agressif est un cancer du système immunitaire qui peut se développer rapidement et nécessiter un traitement urgent. Ce projet se fondera sur une analyse génétique détaillée d’échantillons de lymphomes pour aider à mieux prédire quelles personnes ne répondront pas aux traitements actuels, afin d’améliorer leur prise en charge. Les résultats seront également utilisés pour découvrir de nouveaux traitements qui ciblent les défauts génétiques de ces cancers.
En partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada
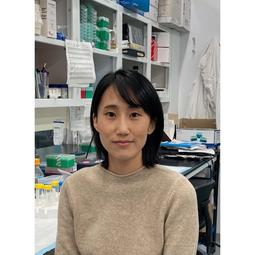
Les immunothérapies contre le cancer qui engagent et redirigent les cellules T de l’hôte pour cibler les tumeurs ont révolutionné le domaine de l’oncologie. Les cellules T jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la croissance des cellules cancéreuses. Dans le myélome multiple, un dysfonctionnement des cellules T entraîne la propagation incontrôlée de plasmocytes anormaux.
Il a été démontré que cibler l’antigène de maturation des cellules B (BCMA) des plasmocytes à l’aide de cellules T à récepteurs antigéniques chimériques (CAR-T) ou d’engageurs de cellules T bispécifiques (TCE) permettait de traiter efficacement les personnes ayant un myélome à un stade avancé.
Malgré ces résultats cliniques encourageants, ces nouveaux traitements ne fonctionnent pas pour tous. Cela souligne l’importance de comprendre comment les cellules du myélome multiple échappent à ces immunothérapies. L’objectif de ce projet est de réaliser un examen approfondi des cellules T dans le myélome multiple.
Cela permettra de mieux comprendre la moelle osseuse des personnes ayant le myélome multiple qui répondent au traitement par TCE par rapport à ceux dont la maladie ne répond pas au traitement. Ces connaissances pourront être utilisées pour guider la prise de décisions sur le moment et le choix du traitement pour chaque patient.

Le lymphome folliculaire (LF) est un cancer du sang fréquent et son évolution peut varier considérablement d’une personne à l’autre. Il faut disposer d’outils fiables (biomarqueurs) pour identifier les personnes ayant un lymphome folliculaire présentant un risque plus élevé de décès afin de leur fournir les soins les plus efficaces. Grâce à des techniques de pointe permettant d’établir le profil des changements génétiques du LF et des interactions entre les cellules de LF et les cellules normales des patients, les chercheurs visent à développer de nouveaux moyens de prédire le comportement de la maladie et de mettre au point des thérapies ciblées.

Lorsqu’une cellule souche sanguine, qui peut se transformer en différents types de cellules sanguines, commence à produire des cellules mutées, on parle d’hématopoïèse clonale. Les membres de l’équipe de recherche ont découvert qu’un type d’hématopoïèse clonale stimule le système immunitaire pour aider les patients à combattre le cancer. L’équipe vérifiera si l’hématopoïèse clonale peut aider à identifier les personnes qui répondent à l’immunothérapie et évaluera comment elle renforce les traitements d’immunothérapie. Les résultats pourraient aider à déterminer les thérapies les plus efficaces et contribuer à la mise au point de nouvelles immunothérapies contre les cancers, notamment la leucémie et le lymphome.
En partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada
La SLLC est heureuse de s’associer à la Société de recherche sur le cancer (SRC) pour cofinancer dix projets sur le cancer du sang dans le cadre du concours de subventions de fonctionnement 2021 de la SRC.
La Société de recherche sur le cancer est un organisme national sans but lucratif dont la seule mission est de financer la recherche sur tous les types de cancer, afin de contribuer à l’avancement des recherches scientifiques visant à prévenir, à diagnostiquer et à traiter la maladie.

La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est un cancer du sang agressif qui répond mal aux traitements actuels. Une nouvelle classe de médicaments, les inhibiteurs d’IDH, a récemment été approuvée pour le traitement des patients atteints de LMA présentant des mutations dans les gènes IDH1 et IDH2. Bien que ces médicaments soient efficaces chez certains patients, beaucoup d’entre eux n’y répondent pas du tout ou voient leur réponse diminuer avec le temps. Il est nécessaire de comprendre pourquoi ce phénomène se produit et de trouver des moyens de rendre ces médicaments plus efficaces. Nous avons récemment découvert que l’activation d’une protéine appelée SYK peut expliquer pourquoi certains patients atteints de LMA ne répondent pas aux inhibiteurs d’IDH. Dans notre proposition de recherche, nous nous appuierons sur ces observations pour étudier comment les changements dans l’activation de SYK agissent sur la réponse des cellules de LMA humaine aux inhibiteurs d’IDH. Nous déterminerons également si le fait de bloquer l’activation de SYK par un autre médicament peut permettre aux cellules de LMA de mieux répondre aux inhibiteurs d’IDH. Nous pensons que nos résultats permettront de découvrir de nouvelles façons d’améliorer l’efficacité des inhibiteurs d’IDH et les perspectives de guérison des patients atteints de LMA.
Toronto ON
Canada

Les dernières avancées dans les traitements du cancer permettent au système immunitaire du patient de combattre les cellules cancéreuses comme s’il s’agissait d’envahisseurs étrangers tels que des bactéries ou des virus. L’un des traitements actuels fait appel aux récepteurs antigéniques chimériques (CAR), qui permettent aux cellules immunitaires de reconnaître les cellules cancéreuses, entraînant la destruction des cellules ciblées. Ces thérapies ont démontré leur efficacité dans le traitement des patients atteints de divers types de leucémie, mais cette approche se heurte à de graves effets secondaires. Les nouvelles architectures des molécules CAR proposées dans cette recherche s’attaquent aux lacunes observées dans la technologie CAR actuelle, ce qui devrait conduire à une amélioration significative de l’élimination des tumeurs tout en réduisant au minimum les effets secondaires et les complications indésirables. En fin de compte, l’efficacité et la sécurité accrues de ces nouvelles molécules mCAR (CAR modulaires) permettront non seulement d’améliorer les résultats pour les patients, mais aussi de réduire les coûts d’hospitalisation généralement associés aux complications liées à la thérapie CAR-T, afin que celle-ci puisse être prise en charge par les régimes de soins de santé subventionnés par l’État, comme c’est le cas au Canada.
Montréal QC
Canada

La chimiothérapie associée à une greffe de cellules souches est souvent le seul traitement curatif pour les patients atteints de leucémie. Malheureusement, les globules blancs contenus dans la greffe de cellules souches peuvent attaquer le patient. Il s’agit d’une maladie grave, qui cause la mort de plusieurs patients chaque année. Les médicaments actuellement utilisés pour traiter cette maladie ne sont pas toujours efficaces. De plus, ces traitements induisent une immunosuppression profonde qui augmente le risque de développer des complications infectieuses létales. La molécule EGFL7 a le potentiel de diminuer les effets secondaires indésirables de la greffe de moelle osseuse. Ce projet vise à étudier la nouvelle molécule EGF7 dans le but de rendre la greffe de moelle osseuse plus sécuritaire pour guérir la leucémie.
Montréal QC
Canada

Les traitements et les résultats pour les patients atteints de cancers du sang se sont considérablement améliorés au cours de la dernière décennie grâce à la mise au point de nouveaux médicaments. Cependant, un important groupe de patients développe souvent une résistance après un traitement pharmacologique continu, ce qui entraîne de mauvais résultats cliniques. Une approche émergente consiste à cibler une protéine appelée « histone désacétylase 6 » (HDAC6), qui s’est révélée être un médiateur de la résistance à la chimiothérapie et peut rendre les tumeurs à nouveau sensibles aux traitements standard. Bien qu’il existe sur le marché quatre médicaments approuvés par la FDA qui ciblent la protéine HDAC6, ils ne sont pas sélectifs et ciblent l’HDAC6 en plus de 10 autres protéines HDAC semblables. Il en résulte des toxicités graves chez les patients. Des médicaments plus récents, qui font l’objet d’essais cliniques de phase I et II, ont montré une sélectivité modeste de 5 à 6 fois plus élevée pour l’HDAC6. Dans le présent projet, nous avons synthétisé de petites molécules inhibitrices qui ont montré une sélectivité exceptionnelle pour l’HDAC6 (>150 fois supérieure). Nous cherchons à développer nos structures chimiques actuelles pour améliorer leurs propriétés pharmacologiques et évaluer leur efficacité dans des modèles de cancer du sang afin de mettre au point de meilleurs traitements et, nous l’espérons, d’améliorer les perspectives de guérison des patients.
Toronto ON
Canada

Les immunothérapies contre le cancer sont mises au point comme un nouveau type de traitement qui agit en renforçant les capacités naturelles du système immunitaire et en l’amenant à détruire les tumeurs. Parmi les différents types de cellules qui composent le système immunitaire, les macrophages ont la capacité d’éliminer les microbes et les cellules cancéreuses en les engloutissant et en les digérant. Toutefois, chez la plupart des patients, les macrophages n’éliminent pas les cellules cancéreuses et freinent plutôt l’activité du système immunitaire contre la tumeur. Les macrophages repèrent les cellules à éliminer en examinant leurs caractéristiques moléculaires et physiques. Des données récentes suggèrent que les caractéristiques physiques des cellules de lymphome les aident à échapper à la phagocytose par les macrophages. Ce projet a pour but de comprendre comment les macrophages pourraient surmonter les contraintes physiques associées à la phagocytose des cellules de lymphome. Plus précisément, nous cherchons à déterminer les deux propriétés essentielles des macrophages pour engloutir les cellules de lymphome : la transmission de force et la déformation cellulaire. La compréhension de ces mécanismes moléculaires permettra d’élaborer de nouvelles stratégies pour la mise au point d’immunothérapies plus efficaces favorisant la destruction des lymphomes par les macrophages.
Burnaby BC
Canada
Le facteur de transcription Ikaros est fréquemment perturbé chez les patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) à cellules B et T et est associé à de mauvais résultats cliniques. Les médicaments chimiothérapeutiques utilisés dans le traitement de la LLA tuent les cellules cancéreuses en endommageant leur matériel génétique (ADN). Nos résultats précédents suggèrent que le facteur Ikaros interagit avec une structure génomique appelée la boucle R et que la mutation d’Ikaros entraîne l’accumulation de boucles R, ce qui peut être toxique. Nous voulons déterminer si la perturbation d’Ikaros favorise l’accumulation de boucles R dans les cellules de LLA en étudiant les mécanismes impliqués, les partenaires protéiques d’Ikaros et l’effet de la perturbation d’Ikaros sur les boucles R génomiques. Nous chercherons à établir si la perturbation d’Ikaros influence l’accumulation de boucles R et la stabilité génomique, ce qui pourrait être fondamental pour déterminer le schéma thérapeutique permettant de guérir la LLA caractérisée par la perturbation d’Ikaros.
Montréal QC
Canada

Les interactions entre les molécules à l’intérieur des cellules transmettent de signaux qui contrôlent les fonctions cellulaires normales. La perturbation de ces voies de signalisation normales est à l’origine de nombreuses maladies humaines. Une mutation génétique bien établie causant la leucémie donne lieu à la production d’une protéine défectueuse appelée BCR-ABL, laquelle perturbe le comportement normal des cellules. La conséquence est une prolifération incontrôlée de certaines cellules sanguines causant des maladies comme la leucémie myéloïde chronique (LMC) et la leucémie lymphoïde aiguë (LLA) de type B. Les médicaments qui désactivent la protéine BCR-ABL sont efficaces dans le traitement de la leucémie, mais chez certains patients, le médicament cesse d’agir parce que les cellules leucémiques deviennent résistantes à ses effets avec le temps. Notre recherche a pour objectif de trouver de nouvelles protéines cibles qui permettront de mettre au point des médicaments susceptibles d’améliorer le traitement des patients atteints de LLA de type B et de LMC, ainsi que des patients dont la leucémie est devenue résistante aux médicaments inhibiteurs de la protéine BCR-ABL.
Toronto ON
Canada

Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire incontrôlée, où chaque cellule doit dupliquer son matériel génomique. Pour répliquer le génome, la cellule doit disposer d’une quantité suffisante des quatre éléments constitutifs (ou désoxynucléotides) de l’ADN. L’un de ces désoxynucléotides, la dTTP, est fabriqué d’une manière particulière et limite la prolifération cellulaire. En raison de leur prolifération rapide, les cellules cancéreuses sont plus sensibles aux médicaments qui inhibent la réplication de l’ADN. Une catégorie de composés très couramment utilisés à cette fin ressemble à un autre désoxynucléotide. Lorsque ces composés sont incorporés dans l’ADN, ils bloquent la réplication et tuent la cellule. L’efficacité de ce traitement est limitée par la présence d’enzymes dans les cellules cancéreuses qui neutralisent les composés. Nous avons ainsi identifié la nouvelle enzyme CDADC1, aux fonctions inconnues, qui pourrait jouer un rôle important dans la prolifération de certaines cellules leucémiques, en facilitant la production de dTTP. Nous avons également découvert que CDADC1 augmente la résistance à au moins un de ces composés anticancéreux (la gemcitabine) dans les cellules cancéreuses cultivées en laboratoire. Nous étudierons le mécanisme par lequel CDADC1 agit sur la toxicité de la gemcitabine et de composés similaires. L’inhibition de l’enzyme CDADC1 pourrait éventuellement améliorer l’efficacité de la gemcitabine et de composés similaires dans le traitement du cancer.
Montréal QC
Canada

Le Dr Rafei étudie activement la biologie d’un sous-groupe de cellules de la moelle osseuse, les cellules stromales mésenchymateuses (CSM). L’un des principaux objectifs de l’équipe du Dr Rafei est de concevoir génétiquement des CSM capables de développer une forte réponse immunitaire pour éliminer les tumeurs présentes, tout en assurant une protection à long terme de la mémoire immunitaire. Les données recueillies jusqu’à présent montrent clairement que ces cellules modifiées sont supérieures aux cellules dendritiques standard (la cellule présentatrice d’antigène la plus puissante connue à ce jour), ce qui indique qu’elles peuvent être exploitées efficacement pour la formulation de nouveaux vaccins contre le cancer issus de cultures cellulaires. Compte tenu de ces résultats concluants, l’objectif de suivi consiste à mieux comprendre le mécanisme qui contrôle la capacité de ces cellules à activer efficacement le système immunitaire, afin de concevoir des vaccins anticancéreux de deuxième ou troisième génération à partir de cultures cellulaires.
Montréal QC
Canada
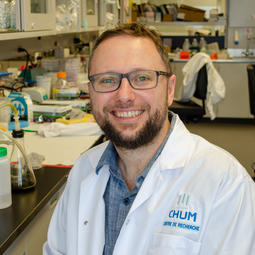
La leucémie lymphoblastique aiguë chez l’enfant est un type de cancer qui touche principalement les enfants de moins de 15 ans. Il y a soixante ans, seuls 3 % des enfants survivaient à la maladie. Aujourd’hui, grâce à la recherche scientifique, plus de 80 % des enfants en guérissent, mais les survivants souffrent de graves effets indésirables tardifs qui rappellent les symptômes du vieillissement prématuré. L’évaluation de ce vieillissement prématuré nécessite un grand nombre de tests cliniques et un suivi clinique tout au long de la vie. Le perfectionnement de cette évaluation permettrait d’améliorer considérablement la qualité de vie des survivants. Nous avons élaboré un test qui mesure un marqueur moléculaire appelé TREC. Il est plus rapide et moins invasif que les tests actuels et peut être réalisé avec un seul échantillon de sang. Dans nos expériences préliminaires, nous montrons que TREC est un marqueur efficace à la fois du vieillissement normal et du vieillissement prématuré induit par le traitement de la leucémie. Notre objectif est de mieux comprendre la pertinence clinique du marqueur TREC et d’évaluer de nouveaux traitements expérimentaux ciblant le vieillissement prématuré afin de réduire les effets secondaires et d’améliorer le suivi clinique des enfants ayant survécu à une leucémie lymphoblastique aiguë.
Montréal QC
Canada
La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) s’associe à BioCanRx pour aider les scientifiques canadiens à mener davantage d’essais cliniques sur la thérapie cellulaire CAR-T.
Le réseau d’immunothérapie du Canada BioCanRx est un réseau de scientifiques, de cliniciens, d’intervenants dans le domaine du cancer, d’établissements universitaires, d’organisations non gouvernementales et de partenaires de l’industrie qui travaillent en collaboration afin d’accélérer le développement d’immunothérapies de pointe pour le bien des patients.
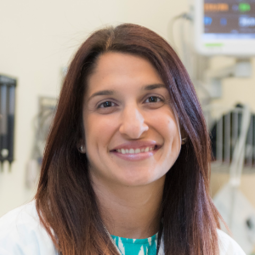
La thérapie cellulaire CAR-T utilise les cellules immunitaires (lymphocytes T) du patient pour repérer et éliminer les cellules cancéreuses. Cette procédure complexe requiert l’extraction des lymphocytes T du sang, puis leur modification génétique en laboratoire afin qu’ils repèrent et tuent les cellules cancéreuses. Ces cellules modifiées sont ensuite réintroduites dans le système sanguin du patient où elles se multiplieront, puis repéreront et élimineront les cellules cancéreuses.
Jusqu’à maintenant, le Canada n’avait pas de laboratoires pour modifier ces lymphocytes T si importants. L’essai clinique de BioCanRx en immunothérapies du cancer dirigées par le Canada (CLIC-01) est unique parce qu’il s’agit du premier essai pour développer et pour fabriquer des cellules CAR-T au Canada. Actuellement, si une personne reçoit une thérapie cellulaire CAR-T, ses lymphocytes T sont envoyés à un laboratoire à l’extérieur du Canada pour leur fabrication. L’essai clinique aidera à accroître notre capacité de production de cellules CAR-T fabriquées au Canada et, au bout du compte, à améliorer l’accès à ce traitement vital.
La Dre Kekre dirige l’essai clinique CLIC-01 de BioCanRx, qui traite des patients atteints d’un cancer du sang récidivant ou réfractaire. Dans le cadre de cette nouvelle étude, la Dre Kekre a utilisé des installations à Ottawa et à Victoria afin de fabriquer les cellules CAR-T pour les premières phases de l’essai clinique, puis des sites d’essai à Ottawa et à Vancouver.
Ottawa ON
Canada
Subventions de recherche – 2021
Nos subventions de fonctionnement offrent un financement pendant deux ans (jusqu’à 100 000 $/année) pour des projets de recherche fondamentale qui contribuent à l’avancement des recherches scientifiques visant à prévenir, à diagnostiquer et à traiter les cancers du sang. Ces subventions sont attribuées à des scientifiques dont le travail contribuera à l’incroyable essor de la recherche sur les cancers du sang et à l’obtention de résultats novateurs dans le traitement et l’espérance de vie.
Les cellules cancéreuses, en particulier les cellules de leucémie lymphoïde chronique (LLC), contiennent plus d’énergie que les lymphocytes B normaux. Nous avons constaté que certains marqueurs sur les cellules leucémiques, comme le ZAP 70, indiquent quelles cellules ont les plus hauts niveaux d’énergie. Toutefois, nous ne savons pas quels facteurs internes ou externes aux cellules influent véritablement sur ZAP 70 de façon à modifier l’état énergétique des cellules. Nous estimons qu’il est important d’obtenir ces informations pour deux grandes raisons : 1) cela pourrait servir à déterminer les doses optimales de nouveaux médicaments à utiliser pour éviter les effets secondaires; 2) nous pourrions découvrir comment combiner les médicaments en vue d’éviter les effets secondaires tout en maximisant l’efficacité du traitement. En déterminant la meilleure façon d’évaluer les variations énergétiques des cellules cancéreuses dans certaines conditions, nous pouvons en apprendre plus sur la manière dont différents médicaments permettent de « vider les batteries » des cellules leucémiques.
Winnipeg MB
Canada
Le vieillissement est associé à la survenue de petits changements (mutations) dans les gènes des cellules sanguines. Certaines de ces mutations peuvent donner, sur le plan de la croissance, un avantage aux cellules touchées, dont le nombre va dépasser celui des cellules saines. Ce phénomène est appelé « hématopoïèse clonale liée à l’âge (HCLA) ». La présence d’une HCLA se caractérise par un risque 10 fois plus élevé de développer un cancer du sang comme la leucémie. En outre, elle double le risque de maladie cardiaque. Le projet proposé permettra de déterminer le rôle de l’inflammation dans le déclenchement de la HCLA, mais aussi dans l’évolution éventuelle vers un cancer ou des maladies cardiovasculaires. Nos résultats pourraient mener à la création d’un test visant le dépistage précoce des personnes à risque et ouvrir la voie à l’élaboration de stratégies d’intervention fondées sur la modification du microbiote ou un traitement anti-inflammatoire.
Montreal QC
Canada
L’injection de cellules immunitaires (cellules T) cultivées dans des laboratoires spécialisés peut être très efficace pour traiter les cancers du sang. Malheureusement, ces cellules immunitaires peuvent se « fatiguer » et sont alors moins efficaces pour éliminer les cellules cancéreuses après leur multiplication en laboratoire. Nous avons découvert qu’en bloquant les « freins » naturels de ces cellules, il était possible de préparer de grandes quantités de cellules immunitaires efficaces contre le cancer. Nous cherchons maintenant à mieux manipuler ces « freins » afin d’améliorer l’efficacité des cellules immunitaires anticancéreuses à des fins de traitement. Ce projet est entièrement axé sur le traitement des cancers du sang et s’appliquera à toutes les formes d’immunothérapies fondées sur les cellules T. En nous appuyant sur notre expertise clinique dans la transposition de thérapies novatrices fondées sur les cellules T, nous cherchons à fournir des cellules T anticancéreuses plus efficaces pour lutter contre les cancers du sang.
Montreal QC
Canada
Nous étudions la forme la plus courante de leucémie chez l’adulte, appelée « leucémie lymphoïde chronique (LLC) ». Bien qu’un grand nombre de nouveaux traitements soient disponibles, il n’existe toujours pas de remède pour la LLC. Les cellules cancéreuses peuvent libérer des particules contenant du matériel qui agit comme messager pour les cellules environnantes. Nous avons découvert que la LLC est plus agressive chez les patients qui présentent une plus grande concentration de particules dans le sang. Nous tenterons de déterminer si ces particules jouent un rôle dans le développement d’une résistance aux médicaments. En outre, il se peut qu’elles puissent modifier la fonction d’autres cellules de l’organisme, créant un environnement propice à la survie des cellules cancéreuses. Enfin, nous utiliserons un modèle 3D de tissus cellulaires pour voir s’il est possible d’éliminer un nombre accru de cellules cancéreuses en bloquant la libération de ces particules. La résistance aux médicaments demeure un obstacle clinique important à la guérison des patients atteints de LLC. Comprendre le rôle que jouent ces particules dans la survie des cellules leucémiques permettrait d’élaborer des stratégies thérapeutiques efficaces pour vaincre la résistance aux médicaments.
Winnipeg MB
Canada
Contourner la résistance à la lénalidomide dans le syndrome myélodysplasique avec del(5q)
Les syndromes myélodysplasiques (SMD) sont un type de cancer du sang associé à un mauvais pronostic et pour lesquels il existe peu d’options thérapeutiques. Chez environ un tiers des patients, le SMD évolue en leucémie aiguë incurable, tandis que le reste d’entre eux décèdent d’une insuffisance de la moelle osseuse. Le médicament appelé « lénalidomide » permet normalement de traiter un type de SMD (SMD avec del(5q)). Toutefois, plus de la moitié des patients qui en sont atteints ne répondent pas ou cessent de répondre au traitement, d’où la nécessité d’élaborer de nouveaux traitements. Notre objectif est de déterminer s’il serait bénéfique de bloquer une voie de signalisation des cellules appelée « IGF1R » chez les patients souffrant de SMD qui résistent à la lénalidomide. Notre travail mènera potentiellement à de nouvelles options de traitement pour ce type de patients.
Vancouver BC
Canada
Les lymphomes non hodgkiniens (LNH) occupent le cinquième rang des cancers les plus diagnostiqués au Canada et sont les cancers du sang les plus répandus. Il devient urgent de trouver de nouvelles options de traitement pour les patients atteints de LNH qui connaissent une rechute après un traitement initial. Jusqu’à présent, les initiatives visant à mettre au point de nouveaux médicaments pour guérir les LNH n’ont généralement pas abouti à la découverte de nouveaux agents permettant d’améliorer les traitements de référence. On sait que les lymphomes agressifs ont besoin d’un apport constant et accru de nutriments pour que la division et la prolifération cellulaires soient possibles. En élaborant des stratégies visant à couper l’approvisionnement en nutriments, nous avons découvert des mécanismes d’adaptation qui permettent aux cellules de lymphome de survivre dans des conditions difficiles. Nous pensons que supprimer l’accès aux sources de nutriments constitue une méthode intéressante pour lutter contre le LNH. Nous avons donc exploité les vulnérabilités métaboliques du LNH afin d’élaborer de nouveaux médicaments, à utiliser en association avec d’autres traitements, qui empêchent les cellules de lymphome de s’adapter aux conditions stressantes.
Toronto ON
Canada
Le projet proposé est axé sur le lymphome à cellules B agressif, pour lequel on dénombre plus de 4 000 nouveaux cas chaque année, ce qui en fait la forme la plus courante de lymphome au Canada. Il est essentiel d’élaborer de nouvelles stratégies de traitement pour les patients qui en sont atteints, puisque 40 % d’entre eux subissent des rechutes qui limitent souvent leur espérance de vie. Notre compréhension des mécanismes de développement du lymphome s’est considérablement améliorée au cours de la dernière décennie. De nouveaux médicaments qui ciblent précisément les protéines essentielles à la prolifération et à la survie des cellules de lymphome sont maintenant disponibles. Cependant, les cellules de lymphome développent souvent une résistance à ces médicaments. Par conséquent, la plupart des nouveaux traitements présentent des taux de réponse relativement faibles; même lorsque les patients y répondent bien, leurs effets peuvent être de courte durée. Dans le cadre de nos recherches, nous tentons de déterminer les associations optimales de médicaments afin de trouver un moyen plus efficace de traiter le lymphome. Nous nous concentrerons sur les médicaments qui peuvent être combinés avec les inhibiteurs de deux protéines, à savoir EZH2 et HDAC3. En plus d’appliquer des méthodes de pointe pour définir de nouvelles associations de médicaments, nous chercherons à comprendre les mécanismes qui expliquent la synergie observée. Notre objectif ultime est d’exploiter ces résultats en vue de mener un essai clinique qui pourra profiter aux patients.
Toronto ON
Canada
Malgré l’amélioration des traitements, le taux de survie relatif sur cinq ans pour les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) est actuellement de 21 % au Canada; le pronostic est particulièrement défavorable pour les personnes âgées. Par conséquent, de nouveaux traitements ciblant les cellules à l’origine de la LMA, c’est-à-dire les cellules souches leucémiques, sont nécessaires. Le traitement de référence actuel pour les personnes âgées souffrant de LMA, une association de venetoclax et d’azacitidine, a considérablement amélioré le taux de survie globale. Toutefois, un tiers des patients ayant répondu au traitement ont fait une rechute, ce qui suggère qu’il ne permet pas d’éradiquer complètement les cellules souches leucémiques; il est donc impératif d’approfondir les recherches dans ce domaine. Les micro-ARN (miARN) exercent des fonctions clés dans les cellules souches leucémiques et leur dérèglement a une incidence sur le pronostic des patients atteints de LMA. En outre, la variation des niveaux de miARN a montré des résultats prometteurs dans les modèles précliniques. Dans le cadre de ce projet, nous étudions la possibilité de cibler les cellules souches leucémiques en inhibant un polycistron de microARN cancérigène en parallèle d’un traitement qui combine venetoclax et azacitidine. L’association proposée est susceptible d’intensifier l’élimination des cellules souches leucémiques et présente donc un potentiel sur le plan clinique pour le traitement de la LMA, mais aussi d’autres cancers comme les lymphomes, le myélome multiple et les tumeurs solides.
Vancouver BC
Canada
À l’intérieur des cellules, les gènes sont disposés le long de molécules torsadées et composées de deux brins d’ADN : les chromosomes. À l’extrémité des chromosomes se trouvent des fragments d’ADN appelés « télomères » qui protègent l’information génétique, permettent aux cellules de se diviser et renferment des secrets sur les mécanismes de vieillissement et d’apparition du cancer. L’entretien de la longueur des télomères est essentiel pour la division et la survie cellulaires. Normalement, lorsque les télomères atteignent une certaine longueur, les cellules cessent de se diviser, puis commencent à se détériorer et à mourir. Toutefois, dans le lymphome hodgkinien, les cellules activent une protéine appelée « télomérase », qui maintient la longueur des télomères et empêche la mort cellulaire. Dans le cadre de ce projet, nous étudierons comment les cellules de lymphome hodgkinien préservent la longueur des télomères, puis nous ciblerons les mécanismes d’entretien des télomères afin d’empêcher la croissance de cellules cancéreuses. Nous pensons que les traitements ciblant les mécanismes d’entretien des télomères présents dans toutes les cellules des patients atteints de lymphome hodgkinien peuvent modifier le pronostic actuel pour ce type de cancer.
Winnipeg MB
Canada
Le lymphome est un cancer des lymphocytes qui peut être traité par chimiothérapie, mais qui est souvent mortel en cas de résistance au traitement. Nous avons déterminé le profil des mutations survenant dans un type de lymphome récidivant, soit le lymphome diffus à grandes cellules B. Nous avons ainsi constaté que la protéine STAT6 subit plus fréquemment des mutations dans les échantillons prélevés sur des patients en rechute que dans les autres. La STAT6 est une protéine qui se lie à l’ADN et contrôle les gènes importants pour la survie des lymphocytes. Lors de nos expériences initiales, nous avons découvert que les cellules présentant des mutations se multipliaient plus rapidement. Nous avons donc tenté de comprendre par quels mécanismes la STAT6 mutante entraîne une intensification de la croissance des cellules cancéreuses. Par la suite, nous vérifierons si les cellules contenant la protéine STAT6 mutante subissent une rechute plus rapide après le traitement par chimiothérapie. En outre, nous pensons que les tumeurs sont susceptibles de répondre à une nouvelle catégorie de médicaments ciblant cette protéine, qu’ils soient utilisés seuls ou combinés à une chimiothérapie. Nous croyons que la protéine STAT6 mutante est un marqueur présent dans les tumeurs qui ne répondront pas bien à la chimiothérapie, mais également dans les tumeurs qui pourraient répondre aux traitements ciblant la STAT6.
Montreal QC
Canada
De nombreux sous-types de leucémies myéloïdes aiguës (LMA) se caractérisent par un échange de matériel génétique qui s’effectue toujours entre les mêmes chromosomes (translocation). Au moment du diagnostic, la translocation est identifiée, et on peut en effectuer le suivi après une chimiothérapie afin d’orienter les choix de traitement ultérieurs. On parle de « suivi de la maladie résiduelle ». La leucémie biphénotypique est un sous-type de leucémie associée à la translocation. Dans le cadre de ce projet, nous utilisons la leucémie biphénotypique comme modèle pour déterminer les translocations chromosomiques survenant dans la leucémie aiguë. Le diagnostic peut être difficile à poser, et il n’existe pas de test établi pour le suivi de la maladie résiduelle dans la leucémie biphénotypique. Notre premier objectif est d’utiliser une nouvelle technologie appelée « séquençage par nanopores » pour repérer les translocations chromosomiques impliquant le gène MLL1. Notre deuxième objectif est d’exploiter les résultats du séquençage par nanopores pour développer des sondes propres aux patients en vue du suivi de la maladie résiduelle. En cas de réussite, ce projet pourrait nous permettre d’élaborer une approche propre au patient pour le suivi de la maladie résiduelle dans de nombreuses maladies en plus de la LMA.
Toronto ON
Canada
L’oncogène cMYC est un important régulateur de l’expression génique, et l’augmentation anormale de son activité est une cause majeure de cancer. Dans de récents travaux, nous avons démontré que cMYC régule l’expression génique dans le sang et le système immunitaire avec l’aide d’une autre protéine, MYSM1. Une perte de MYSM1 peut donc protéger les souris des cancers du sang et du système immunitaire. Dans le cadre du projet proposé, nous analyserons les mécanismes moléculaires impliqués dans l’interaction de MYSM1 et cMYC. L’objectif à long terme est de déterminer si l’inhibition de MYSM1 entraînera également l’inhibition de l’activité de c-MYC et fournira ainsi une autre option de traitement potentielle.
Montreal QC
Canada
L’inflammation est étroitement liée au développement et à l’évolution du cancer. Les plaquettes font partie des composants qui participent à l’inflammation dans ces processus. Les plaquettes, initialement découvertes pour leur effet coagulant, occupent le deuxième rang des cellules sanguines circulantes les plus abondantes dans le corps humain. Il est intéressant de noter que les plaquettes rejettent également de petites vésicules (semblables à des capsules d’évacuation) qui renferment des molécules biologiquement actives. Nous avons récemment identifié un nouveau type de vésicules, appelées « mitoMP ». Ces mitoMP contiennent des mitochondries, composants qui sont connus pour fournir de l’énergie à chaque cellule. Nos résultats initiaux montrent que les mitoMP se lient aux cellules leucémiques, qui les enveloppent afin que les mitoMP puissent transférer leur contenu (mitochondries). Par conséquent, ces cellules cancéreuses sont très viables et possèdent une résistance accrue à la mort cellulaire. Nous pensons que les mitoMP représentent d’importants modulateurs de cancers, ce qui se traduirait par une évolution notable de la maladie. Dans le cadre de cette étude, nous proposons de définir l’importance des mitoMP dans la leucémie lymphoïde chronique. Plus important encore, nous en déterminerons les mécanismes pathologiques, ce qui permettra ensuite l’élaboration de nouvelles stratégies en matière d’approches thérapeutiques.
Financement en partenariat avec la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB)
Moncton NB
Canada
Cibler l’ubiquitine ligase E1 (UBA1) dans la leucémie myéloïde aiguë
Le TAK-243 est un nouveau médicament qui bloque le système d’élimination des déchets des cellules. Nous avons montré que le TAK-243 tue les cellules de leucémie myéloïde aiguë (LMA) dans les modèles de culture et murins tout en épargnant les cellules saines. En nous fondant sur ces données, nous proposons un essai clinique du TAK-243 chez les patients atteints de LMA réfractaire. À l’appui de cet essai clinique, nous mettrons au point un test en laboratoire afin de déterminer si le TAK-243 peut se lier à sa cible et l’inhiber. Nous étudierons également les mécanismes par lesquels les cellules développent une résistance au TAK-243. Enfin, nous testerons de nouvelles associations de médicaments qui pourraient améliorer la capacité du TAK-243 à tuer les cellules de LMA, mais à épargner les cellules saines.
Toronto ON
Canada
Les lymphomes se classent au cinquième rang des cancers les plus courants au Canada. Le traitement de référence actuel pour beaucoup de lymphomes à cellules B consiste en une chimiothérapie et un traitement par anticorps monoclonaux; il a considérablement amélioré le pronostic des patients au cours des 15 dernières années. Cependant, une grande partie des patients souffrent de lymphomes réfractaires ou récidivants. Par conséquent, l’élaboration de nouvelles stratégies thérapeutiques pour ces patients représente un besoin important sur le plan clinique qui n’a pas encore été comblé. Nous étudierons les rôles d’un nouveau gène, appelé « PRAME », qui est souvent éliminé dans les tumeurs des patients. Toutefois, le rôle fonctionnel de cette suppression du gène PRAME reste inconnu. Nous tenterons d’expliquer comment ces délétions conduisent à la formation de lymphomes et comment les cellules tumorales échappent à la vigilance du système immunitaire des patients, ce qui contribuera à l’élaboration de nouvelles approches thérapeutiques permettant de traiter simultanément la tumeur et l’hôte.
Codemandeurs : Dr James Whitlock, Dre Sonia Cellot, Dr Daniel Sinnett, Dr Stephen Couban
Bien que les taux de guérison de la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) chez les enfants se soient sensiblement améliorés dans le contexte actuel, la rechute reste la cause la plus fréquente d’échec du traitement et de décès. Le pronostic des adolescents et des jeunes adultes atteints de LLA est moins bon que celui des plus jeunes. Les avancées en génétique oncologique ont récemment donné lieu à plusieurs découvertes importantes, comme l’identification d’un groupe particulier de patients qui présentent une « signature génétique » semblable à celle de la LLA à chromosome Philadelphie (Ph) positif, mais qui ne possèdent pas le chromosome Ph. On parle de LLA dite « Ph-like ». Ce type de LLA comprend environ 15 % des enfants et plus de 25 % des adultes atteints de cette maladie. Malgré les chimiothérapies modernes, ce groupe présente des taux de survie médiocres par rapport aux patients souffrant d’autres formes de LLA. L’accès aux tests de dépistage pour la LLA dite « Ph-like » reste limité au Canada : environ 500 patients par année en sont privés. Compte tenu du mauvais pronostic et de la possibilité de l’améliorer, l’objectif principal de cette étude consiste à mettre au point un programme national de dépistage pour la LLA dite « Ph-like » à l’aide d’une nouvelle technologie de séquençage. Ce dépistage permettra d’identifier les patients atteints de cette forme de LLA dont le pronostic pourrait s’améliorer s’ils suivaient un traitement par TKI en plus d’une chimiothérapie conventionnelle.
Montreal QC
Canada
Déficits neurocognitifs tardifs chez les survivants de la leucémie lymphoblastique aiguë : les biomarqueurs de méthylation de l’ADN
Le traitement de la leucémie infantile est très efficace; cependant, il peut nuire au développement normal du cerveau chez une proportion d’enfants traités pouvant atteindre 50 %. Les fonctions cérébrales comme l’attention, la mémoire et l’intelligence peuvent être touchées, ce qui entraîne des problèmes sur le plan de l’apprentissage et des aptitudes sociales. Il est important de noter que ces effets peuvent n’apparaître que plusieurs années après la fin du traitement : on parle donc d’« effets tardifs ». Nos récentes recherches suggèrent que les profils des marqueurs épigénétiques, c’est-à-dire les changements dans l’ADN qui contrôlent l’activation ou la désactivation des gènes, peuvent nous aider à comprendre comment les effets tardifs se développent chez les survivants de la leucémie. Ces marqueurs épigénétiques sont stables au fil des années qui suivent le traitement et peuvent être utilisés pour prédire ses effets néfastes sur le développement du cerveau. Notre étude vise à identifier les marqueurs épigénétiques présents dans les cellules de la moelle osseuse qui ont été recueillies lors d’analyses de routine effectuées au début du traitement par chimiothérapie afin d’en apprendre davantage sur les causes possibles des effets tardifs. Ces informations pourraient nous aider à déterminer quels enfants sont les plus susceptibles de manifester des effets tardifs. En outre, ces résultats permettront de mieux comprendre les mécanismes des effets tardifs et l’apparition de biomarqueurs précoces ainsi que d’étudier la possibilité d’interventions précoces personnalisées.
Toronto ON
Canada
Dans les immunothérapies actuelles fondées sur les cellules CAR-T, des cellules T matures sont prélevées dans le sang du patient, modifiées pour tuer les cellules leucémiques et de lymphome, et retransplantées chez le patient. La mise en œuvre réussie de cette stratégie est limitée par les coûts de traitement élevés, les faibles rendements cellulaires et les préoccupations en matière de sécurité à long terme. De nombreuses cellules CAR-T reconnaissent à la fois les cellules cancéreuses et les cellules saines, ce qui entraîne des effets secondaires indésirables. Une source « universelle » de cellules (pro-)T progénitrices conçues pour cibler certaines cellules cancéreuses pourrait être transplantée chez le patient; ces cellules se développeraient alors en cellules T matures tolérées par le système immunitaire du patient, ce qui réduirait les effets secondaires potentiels au minimum. Nous avons mis au point une façon d’obtenir des cellules pro-T à partir de cellules souches et cherchons à démontrer qu’il s’agit d’un moyen efficace de traiter les cancers du sang. L’optimisation du traitement fondé sur ce type de cellules devrait permettre de cibler uniquement les tissus cancéreux, de réduire les effets secondaires et d’accroître la puissance des traitements contre de nombreux types de leucémies et de lymphomes. En outre, le développement de cellules pro-T entraînerait la production à grande échelle d’immunothérapies contre le cancer facilement accessibles, ce qui abaisserait les coûts pour les patients.
Vancouver BC
Canada
En cette époque marquée par la mise au point de médicaments ciblés et immuno-oncologiques chez l’adulte, on constate que très peu de ces nouveaux remèdes efficaces ont été adaptés pour traiter les cancers du sang chez l’enfant.
Malgré de nettes avancées dans le domaine, les taux de guérison demeurent faibles pour certains types de cancers du sang et les thérapies traditionnelles continuent d’entraîner des effets importants à long terme.
Ces projets visent à changer la donne en matière de cancers du sang chez l’enfant et à répondre aux besoins non comblés dans ce domaine.

Le taux de survie pour la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) de type B, le cancer le plus fréquent chez l’enfant, dépasse désormais 85 %. Toutefois, le traitement de la LLA qui pénètre dans le système nerveux central (SNC incluant le cerveau et la moelle épinière) présente un enjeu de taille. On sait que les cellules de la LLA atteignent le SNC. De fait, la première avancée dans un traitement efficace de la leucémie comportait une irradiation préventive du SNC et l’injection de médicaments chimiothérapeutiques dans le liquide céphalo-rachidien.
Il reste maintenant à résoudre deux grands problèmes :
Savoir comment les cellules de la LLA pénètrent dans le SNC et quels enfants sont les plus à risque
Mettre au point des traitements efficaces qui bloquent l’envahissement du SNC et sont moins nocifs pour le développement cérébral des enfants
L’équipe de recherche a découvert deux nouvelles voies d’entrée pour les cellules de la LLA dans le SNC. Qui plus est, elle a démontré l’efficacité des nouveaux médicaments potentiels pour bloquer ces voies d’entrée. Elle s’efforce maintenant de mieux comprendre le mécanisme d’envahissement du SNC par les cellules leucémiques pour mettre au point un test performant afin de détecter les enfants les plus à risque pour cette maladie. Les résultats de cette recherche serviront à étayer les futurs essais cliniques sur les nouveaux médicaments destinés à prévenir et à traiter efficacement les rechutes dans le SNC pour assurer une meilleure qualité de vie aux survivants.

Il est difficile d’expliquer les origines de la leucémie chez l’enfant, puisque les premières altérations génétiques surviennent pendant la grossesse.
Le syndrome de Down se doit à la présence d’un chromosome surnuméraire à la 21e paire (trisomie 21) et les enfants qui en sont atteints ont un risque 150 fois supérieur de présenter un syndrome myélodysplasique qui évolue souvent en leucémie. Dans une récente étude marquante, l’équipe de recherche a démontré que la préleucémie liée au syndrome de Down ne se développe qu’à partir de rares cellules souches hématopoïétiques (CSH). Il reste à élucider comment la trisomie 21 conduit les CSH à devenir cancéreuses.
Le Dr Dick et son équipe partent de l’hypothèse qu’un dysfonctionnement des cils cellulaires (structures ressemblant à des cheveux à la surface des cellules) joue un rôle méconnu dans les cellules sanguines et l’hématopoïèse (formation de cellules sanguines) anormale en cas de trisomie. Toutefois, la fonction hématologique ou la malignité n’ont jamais été liées à des anomalies des cils.
Dans un premier temps, les chercheurs examineront environ 120 000 cellules sanguines progénitrices (immatures) à l’aide d’analyses de pointe de la structure de l’ADN, de l’ARN et des protéines, afin de révéler les différences entre cellules sanguines saines et trisomiques. L’étude vise à donner un aperçu de l’incidence de la trisomie 21 sur l’apparition de la leucémie.

Les chimiothérapies modernes permettent de guérir la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) chez la plupart des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Malheureusement, dans les cas de LLA associée à certaines mutations génétiques à haut risque – ou LLA de type Philadelphie (LLA Ph) –, les résultats demeurent médiocres. Ce sous-type, courant chez les enfants, touche plus fréquemment les personnes d’origine hispanique et autochtone. La LLA Ph récidive souvent, en dépit des meilleures chimiothérapies.
Un nouveau traitement ciblé, le ruxolitinib, est parvenu à bloquer une voie de signalisation importante qui contribue à l’activité cancéreuse des cellules de la LLA Ph. Un essai clinique de phase 2 est en cours pour vérifier si l’association du ruxolitinib à la chimiothérapie diminue les rechutes chez les enfants atteints de LLA Ph. Néanmoins, des récidives chez certains de ces patients laissent penser que les cellules leucémiques ont trouvé un moyen de déjouer l’action du médicament et de devenir résistantes.
Dans le cadre de ce projet, les chercheurs étudient des échantillons de sang et de moelle osseuse prélevés sur des enfants atteints de LLA Ph et participant à l’essai clinique. Ils espèrent découvrir la façon dont les cellules leucémiques déjouent l’action des médicaments et provoquent une rechute, qu’il s’agisse de mutations de l’ADN, ou de modifications des voies de signalisation cellulaire. Les résultats serviront à mettre au point de nouvelles thérapies qui s’attaquent à d’autres cibles dans les cellules leucémiques afin de surmonter ou même d’éviter la résistance au ruxolitinib chez ces patients.
En partenariat avec Kindred Foundation

La leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) est le cancer le plus fréquent chez l’enfant. En raison des taux de guérison remarquables obtenus par les traitements modernes, les recherches se concentrent maintenant sur la réduction de la toxicité de la chimiothérapie. Les traitements anticancéreux intensifs entraînent des réactions indésirables graves, voire des effets secondaires à long terme. Il semble que le risque pour l’enfant de développer des toxicités liées au traitement dépend de facteurs génétiques.
Ce projet analysera la génétique des réactions indésirables graves dans la LLA infantile. Lors d’études précédentes, les chercheurs ont découvert des variations génétiques, mais il reste à savoir si ces variations permettent de prédire les réactions indésirables graves et de déterminer comment les utiliser pour mieux ajuster le traitement. Cette étude vise à répondre à ces questions et fournir des informations importantes sur la façon dont la génétique d’une personne influe sur sa réaction à certains médicaments, en vue d’améliorer les traitements destinés aux enfants atteints de LLA.

La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est un cancer du sang de pronostic médiocre. À l’heure actuelle, il ne se traite que par des chimiothérapies entraînant des séquelles sur le développement physique et mental des enfants.
La COVID-19 et les traitements à base d’ARNm ont complètement changé la donne. Leur succès réside dans l’encapsulation des ARNm dans des nanoparticules lipidiques (NPL).
Le groupe du Dr Kuchenbauer et d’autres chercheurs ont récemment découvert le potentiel des microARN (miARN) encapsulés dans des NPL pour cibler des mutations spécifiques dans les leucémies, avec des effets secondaires limités. Selon les données antérieures de l’équipe, le miR-193a (un gène associé au cancer) diminue fortement chez les enfants atteints de LMA de caryotype normal (LMA CN). Dans les cas de LMA-CN, on a démontré que la surexpression artificielle du miR-193 ralentissait la progression de la LMA.
Les chercheurs étudient actuellement un médicament à base de miR-193a-3p (INT-1B3) dans des NPL dans le cadre d’un essai clinique sur les tumeurs solides afin de le tester sur des modèles pédiatriques de LMA-CN. Ils visent à mettre au point de nouvelles formulations à base de miARN encapsulées dans des NPL pour le traitement de la LMA chez les enfants. Cette approche novatrice contribuera à réduire le fardeau de la chimiothérapie pour les enfants, à améliorer les résultats du traitement et à favoriser un développement normal pour ces patients fragiles et moins bien servis.
En partenariat avec Kindred Foundation

Les leucémies myéloïdes aiguës (LMA) sont des cancers difficiles à traiter qui résultent de mutations (changements) des cellules souches sanguines normales produites dans la moelle osseuse. En cas de diagnostic de LMA, chez environ 25 % des enfants, les cellules cancéreuses migrent vers le système nerveux central (SNC) avec des conséquences neurologiques potentielles à long terme. Ces patients doivent faire l’objet d’un traitement plus intensif pour prévenir une rechute dans le SNC. Malheureusement, on manque de descriptions précises sur les caractéristiques des rares cellules infiltrant le SNC.
Dans le cadre de cette étude, les chercheurs vont évaluer s’ils peuvent diagnostiquer plus précisément l’infiltration du SNC chez des enfants atteints de LMA pour mieux comprendre cette complication. Ils évalueront l’efficacité d’une technique appelée séquençage de l’ARN de cellules uniques pour diagnostiquer les cellules infiltrant le SNC chez ces patients, notamment lorsque l’examen microscopique ne détecte qu’un très petit nombre de cellules.
L’étude déterminera si le séquençage de l’ARN de cellules uniques permet de prédire quels enfants atteints de LMA, avec infiltration du SNC, pourraient tirer profit d’un traitement plus intensif. Elle fournira également une première exploration de l’expression génique et des mutations spécifiques aux cellules infiltrant le SNC dans cette maladie.

La leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) est le cancer le plus fréquent chez les enfants. Quant à la LLA avec hyperdiploïdie (HD), elle représente environ 20 % des diagnostics de leucémie pédiatrique chaque année et répond très bien aux traitements actuels.
Cependant, cette réussite masque souvent une autre réalité, la LLA-HD demeure le principal facteur de rechute de la LLA et, en cas de rechute, le taux de guérison est inférieur à 50 %. La recherche de nouvelles stratégies thérapeutiques s’impose donc.
Au cours de cette étude, les chercheurs exploreront la biologie de la LLA-HD pour découvrir de nouveaux types de traitement. Pour ce faire, ils utiliseront un modèle unique afin de réaliser des expériences, auparavant difficiles, pour suivre la progression de la leucémie depuis son tout début. Ils pourront ainsi détecter les changements communs à toutes les cellules anormales dans la LLA-HD. Les résultats de cette étude devraient déboucher sur des moyens efficaces de réduire l’incidence des rechutes de la LLA-HD en éradiquant les cellules leucémiques qui échappent aux traitements actuels.

La greffe de moelle osseuse permet de guérir les cancers du sang. Cependant, même si l’innocuité et l’efficacité de la greffe du donneur se sont améliorées dans les dernières décennies, le risque de complication auto-immune potentiellement mortelle, appelée « maladie chronique du greffon contre l’hôte », en limite l’application.
Cette complication survient lorsque les cellules du donneur (le greffon) attaquent les cellules saines de l’hôte. Pour savoir quels patients risquent le plus de développer la maladie du greffon contre l’hôte et quels traitements conviennent le mieux à chacun, l’équipe canadienne ABLE (Applied Biomarkers in Late Effects of Children and Adolescents with Cancer) s’efforce de découvrir les biomarqueurs (molécules biologiques signalant un processus, un état ou une maladie). Les études réalisées par l’équipe ABLE ont détecté des taux d’enzyme sCD13 élevés chez les patients atteints de la maladie chronique du greffon contre l’hôte.
Au cours du projet, l’équipe de recherche étudiera les effets de la sCD13 sur les cellules immunitaires et sa contribution à la maladie chronique du greffon contre l’hôte. Elle examinera aussi l’action de la Bestatine, un inhibiteur de la sCD13, sur l’évolution de la maladie. Si l’équipe parvient à démontrer que l’inhibition de la sCD13 peut éliminer la maladie, elle sera alors prête à lancer un essai clinique pour déterminer si cette approche réduit l’incidence et la gravité de cette maladie en vue de faire de la greffe de moelle osseuse un traitement plus sûr pour les enfants et les adolescents.

Le lymphome hodgkinien (LH) est l’un des cancers les plus fréquents chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Le taux de survie des patients atteints de lymphome hodgkinien a remarquablement progressé au cours des dernières décennies. Néanmoins, l’issue demeure très incertaine en cas de récidive de la tumeur après traitement. Qui plus est, les effets secondaires de ce traitement comme l’infertilité, les cancers secondaires et les maladies cardiaques constituent un problème sérieux pour les jeunes survivants du LH. La recherche sur les marqueurs biologiques associés à l’échec thérapeutique devient donc une priorité absolue afin de prolonger la survie tout en réduisant les effets secondaires.
Dans le cadre de cette étude, l’équipe de recherche décodera l’écosystème du microenvironnement tumoral dans les biopsies du LH à l’aide d’une nouvelle technologie appelée cytométrie de masse par imagerie (CMI). En réalisant une CMI complète sur les biopsies des patients, l’équipe tentera de découvrir des variations significatives sur le plan clinique dans la composition cellulaire du microenvironnement tumoral afin de mieux comprendre la biologie du LH chez l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte. Ces résultats biologiques devraient déboucher sur des tests diagnostiques utilisables dans la pratique clinique courante pour personnaliser les traitements et augmenter les taux de guérison, tout en diminuant la toxicité.
En partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), nous encourageons les spécialistes en milieu clinique débutants à poursuivre une carrière dans la recherche sur les cancers du sang grâce à une subvention sur trois ans. Cette dernière vise à favoriser l’acquisition de compétences et l’autonomie pour mener des recherches sur les cancers du sang en laboratoire, en clinique ou dans un milieu mixte.

Le syndrome myélodysplasique (SMD) et la leucémie myéloïde aiguë (LMA) restent des défis cliniques importants, seule une fraction des patients parvenant à survivre à long terme. Le traitement le plus couramment utilisé en Amérique du Nord est la 5-azacitidine (5-aza), et si la 5-aza est efficace pour certains patients, 40 % des patients traités n’y répondent pas. On ne sait pas pourquoi les patients deviennent résistants à la 5-aza et, étant donné son importance dans le traitement du SMD et de la LMA, il est nécessaire de comprendre les mécanismes de la résistance à la 5-aza. L’objectif de ce projet est de déterminer pourquoi les patients sont résistants à la 5-aza, et de fournir des informations pour mettre au point de nouveaux traitements.
Vancouver BC
Canada
En partenariat avec notre société affiliée américaine, la Leukemia and Lymphoma Society, nous offrons des bourses de perfectionnement professionnel à des postdoctorants, à des chargés de cours et à des chercheurs indépendants en début de carrière qui effectuent des recherches fondamentales, translationnelles ou cliniques pour comprendre et traiter les affections malignes hématologiques et des maladies prémalignes pertinentes.
La leucémie est le cancer le plus courant chez les enfants, à raison d’un cancer sur trois. Elle est encore plus répandue chez les enfants atteints du syndrome de Down, une anomalie chromosomique causée par une troisième copie du chromosome 21. Durant la petite enfance, ces derniers ont notamment 150 fois plus de risques de contracter la leucémie myéloïde aiguë. Chez 30 % des nouveau-nés atteints du syndrome de Down, une maladie préleucémique transitoire apparaît. Au cours de cette préleucémie, des globules blancs immatures appelés mégacaryoblastes se divisent de façon incontrôlable et peuvent endommager plusieurs tissus. Chez la plupart des patients, ce problème se règle spontanément. Toutefois, dans 20 % des cas, la maladie préleucémique récidive et se transforme en leucémie myéloïde aiguë. L’objectif global de la présente proposition est de nous permettre de comprendre pourquoi une copie supplémentaire du chromosome 21 prédispose les enfants atteints du syndrome de Down à la leucémie et de comprendre le mécanisme d’apparition et d’évolution de la leucémie. À long terme, le Dr Wagenblast souhaite empêcher la progression de la préleucémie en leucémie myéloïde aiguë en éliminant les cellules préleucémiques, une éventuelle stratégie de prévention générale pour les enfants atteints du syndrome de Down ayant reçu un diagnostic de préleucémie.
Toronto ON
Canada
En partenariat avec la Société canadienne du cancer (SCC), nous finançons un projet de recherche passionnant dans le cadre du programme d’applications de technologies novatrices pour la prévention et la détection précoce du cancer. L’objectif du programme est d’amorcer et d’accélérer le développement ou l’application d’approches réellement novatrices pour la prévention et la détection précoce du cancer.
La leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) est le type de cancer du sang infantile le plus fréquent. La prise en charge clinique des rechutes et des LLA résistantes au traitement pose des difficultés considérables. Si nous parvenons à diagnostiquer les nouveaux cas et les rechutes plus rapidement, nous pourrons commencer les traitements le plus tôt possible, ce qui en améliorera les probabilités de réussite. La Dre Krajinovic et son équipe tentent donc de déterminer si de petits fragments d’ADN circulaires récemment découverts sont des marqueurs efficaces et stables de la maladie, puisque l’ADN est habituellement linéaire. Les chercheurs s’efforcent d’identifier la signature de l’ADN circulaire et d’optimiser une technique d’analyse qui leur permettrait de déceler ces marqueurs de façon rapide et rentable. Cette approche pourrait changer radicalement la manière dont les enfants ayant la LLA sont pris en charge et prolonger leur espérance de vie.
Montreal QC
Canada
En partenariat avec notre société affiliée américaine, la Leukemia & Lymphoma Society, nous octroyons des subventions à des chercheurs canadiens dans le cadre du programme de recherche translationnelle. Il s’agit d’un tremplin qui propulse la recherche sur les traitements contre les cancers du sang et les remèdes, du banc d’essai au chevet du patient. Grâce à ce programme, nous finançons des recherches inédites et très prometteuses visant à trouver des applications cliniques à des connaissances biomédicales de base.
Comparativement aux cellules normales, les cellules cancéreuses sont souvent caractérisées par des changements substantiels de leur surface visant à atténuer leurs propriétés oncogéniques. Parmi les facteurs sur cette surface, on trouve notamment des transporteurs multirésistants qui pompent des médicaments hors de la cellule, des enzymes qui contribuent à la décomposition du tissu environnant pour permettre aux cellules cancéreuses de migrer et d’envahir d’autres parties du corps, ainsi que des caractéristiques qui aident les cellules à survivre dans le microenvironnement tumoral. Les changements apportés à l’architecture de la surface cellulaire peuvent donc grandement altérer la mobilité des cellules et la façon dont ces dernières réagissent aux signaux de croissance et aux médicaments. Nous avons découvert que l’oncoprotéine eIF4E est un facteur susceptible de modifier considérablement la surface cellulaire, une capacité cancérigène critique. La proportion d’eIF4E est élevée chez les personnes atteintes de LMA, de lymphome ou d’une autre hémopathie maligne. Nous examinerons l’incidence d’eIF4E sur le microenvironnement tumoral pour démontrer qu’eIF4E peut altérer les cellules par des moyens extracellulaires, c’est-à-dire contrôler le microenvironnement tumoral « à distance ».
Montreal QC
Canada
Cibler l’ubiquitine ligase E1 (UBA1) dans la leucémie myéloïde aiguë
Le TAK-243 est un nouveau médicament qui bloque le système d’élimination des déchets des cellules. Nous avons montré que le TAK-243 tue les cellules de leucémie myéloïde aiguë (LMA) dans les modèles de culture et murins tout en épargnant les cellules saines. En nous fondant sur ces données, nous proposons un essai clinique du TAK-243 chez les patients atteints de LMA réfractaire. À l’appui de cet essai clinique, nous mettrons au point un test en laboratoire afin de déterminer si le TAK-243 peut se lier à sa cible et l’inhiber. Nous étudierons également les mécanismes par lesquels les cellules développent une résistance au TAK-243. Enfin, nous testerons de nouvelles associations de médicaments qui pourraient améliorer la capacité du TAK-243 à tuer les cellules de LMA, mais à épargner les cellules saines.
Toronto
Canada
Aux États-Unis, le lymphome folliculaire est le deuxième type de lymphome le plus souvent diagnostiqué. Malgré les avancées récentes, cette maladie demeure largement incurable et progresse chez la grande majorité des patients. Certains peuvent être en rémission pendant 10 ans ou plus après le traitement initial et ont donc un pronostic favorable, tandis que d’autres risquent de mourir prématurément d’un lymphome qui évolue de manière précoce. Ainsi, même si tous ces patients reçoivent un diagnostic pour le même type de lymphome, leurs pronostics sont extrêmement variables. Il y a de plus en plus d’options de traitement, mais nous ne sommes actuellement pas en mesure d’adapter le traitement à chaque patient pour deux raisons : 1) nous ne pouvons pas prévoir avec exactitude le risque de progression avant le début du traitement; 2) nous ne savons pas quel traitement serait plus avantageux pour chaque patient. Nous proposons donc de combler ces deux lacunes pour améliorer le pronostic des patients atteints de lymphome folliculaire grâce à un diagnostic plus précis de la génétique tumorale pour une thérapie plus personnalisée.
Toronto ON
Canada
En partenariat avec notre société affiliée américaine, la Leukemia & Lymphoma Society, nous octroyons des subventions de recherche visant à rassembler des chercheurs établis d’un ou de plusieurs établissements pour développer un programme de recherche ciblé, favoriser de nouvelles interactions et collaborations et améliorer la recherche interdisciplinaire chez les participants. L’objectif général est d’améliorer le développement de stratégies novatrices pour le traitement, le diagnostic ou la prévention des hémopathies malignes. Les stratégies qui permettent de faire passer les découvertes du banc d’essai au chevet du patient sont d’une importance capitale, tout comme les projets de recherche translationnelle intégrée.
Le pronostic des personnes ayant la leucémie myéloïde aiguë ou le lymphome T périphérique est sombre, et les possibilités de traitement sont limitées. Une mutation de trois gènes aux fonctions similaires (TET2, DNMT3A et IDH) contribue à l’apparition de ces deux maladies, mais nous ne savons pas exactement comment. De nouvelles thérapies pour contrer les effets de ces mutations sont en cours de développement, mais même les plus prometteuses pourraient être efficaces uniquement pour un sous-ensemble de patients. Une meilleure compréhension de la façon dont ces mutations contribuent à l’apparition de la leucémie et du lymphome ainsi que de leur incidence sur la résistance au traitement nous permettra de mettre au point de nouvelles thérapies plus efficaces. Le Dr Mak et son équipe examinent l’ADN et les protéines de cellules individuelles pour déterminer comment ces mutations provoquent la maladie et lui permettent de résister à la thérapie.
Toronto ON
Canada
Pour obtenir des renseignements sur les projets de recherche financés avant 2021,
veuillez communiquer avec nous.